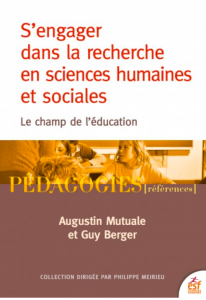Manuel de l’autorité. La comprendre et s’en saisir
Auteur : Camille Roelens, Chronique sociale, 2021, 116 pages, ISBN : 236-717-7775
Par Jean-François Dupeyron, Univesrité de Bordeaux, France
 La dimension réflexive de l’accompagnement Camille Roelens, docteur en sciences de l’éducation, occupe actuellement un poste universitaire dans le domaine de la formation des enseignants. Ses travaux de recherche croisent fréquemment des questions relevant de la philosophie de l’éducation et des questions relatives à la philosophie politique. Le présent ouvrage donne un bon aperçu de cette approche croisée, puisqu’il confronte un thème classique de l’éducation (l’autorité) avec des préoccupations liées à l’évolution de la démocratie à l’âge de l’individualisme et de la fin des « grands récits » holistiques. Pour accomplir ce programme, l’auteur reprend certaines analyses proposées par sa récente thèse de doctorat, afin de les mettre à disposition des praticiens des relations d’autorité et, au-delà, de toute personne s’interrogeant sur le fonctionnement des relations d’influence propres à la (post) modernité démocratique. L’objectif est donc clair : non pas dicter une « méthode infaillible » pour « faire autorité » (programme impossible), mais accompagner les lecteurs dans leur connaissance de l’autorité afin de « la comprendre » et de « s’en saisir », comme l’énonce le sous-titre de l’ouvrage.
La dimension réflexive de l’accompagnement Camille Roelens, docteur en sciences de l’éducation, occupe actuellement un poste universitaire dans le domaine de la formation des enseignants. Ses travaux de recherche croisent fréquemment des questions relevant de la philosophie de l’éducation et des questions relatives à la philosophie politique. Le présent ouvrage donne un bon aperçu de cette approche croisée, puisqu’il confronte un thème classique de l’éducation (l’autorité) avec des préoccupations liées à l’évolution de la démocratie à l’âge de l’individualisme et de la fin des « grands récits » holistiques. Pour accomplir ce programme, l’auteur reprend certaines analyses proposées par sa récente thèse de doctorat, afin de les mettre à disposition des praticiens des relations d’autorité et, au-delà, de toute personne s’interrogeant sur le fonctionnement des relations d’influence propres à la (post) modernité démocratique. L’objectif est donc clair : non pas dicter une « méthode infaillible » pour « faire autorité » (programme impossible), mais accompagner les lecteurs dans leur connaissance de l’autorité afin de « la comprendre » et de « s’en saisir », comme l’énonce le sous-titre de l’ouvrage.
À cet effet, le souci heuristique (comprendre) voisine étroitement avec la préoccupation pratique (décrypter des situations concrètes et se positionner en tant qu’acteur de l’autorité). C’est donc, selon nous, en connaissance de cause, que l’auteur a fait le choix de la forme du Manuel comme support de son « petit essai » (p. 85). Ce choix, pour les philosophes, n’est pas anodin. Certes, en un sens étroit, le terme Manuel désigne tout ouvrage pédagogique de faible volume, ainsi nommé car il « tient dans la main », ce qui le rend portatif et pratique. Dans cet esprit, le manuel se tient à distance des sommes théoriques et des traités abstraits, pour se limiter à des contenus adaptés et décantés en vue de leur utilisation au sein d’un apprentissage. Roelens, par ce choix, peut donc mettre en concordance son objectif (« comprendre et saisir ») et la forme de son écrit. De plus, en un second sens, l’usage de la forme du manuel peut s’entendre comme une réplique de la conception antique voyant la finalité de l’œuvre philosophique écrite, non dans l’exposé d’un système, mais dans la production d’un effet de formation. Puisque philosopher, c’est s’exercer à vivre, alors les écrits philosophiques ne sont pas du tout le réceptacle d’un dogme ; ils offrent plutôt l’occasion de s’exercer à comprendre, voire à agir, en gardant toujours sous la main l’appui de références et d’exemples. Là est le cœur de l’intention propre au Manuel. Ainsi, pour Pierre Hadot (2002), « l’écriture n’est qu’un aide-mémoire, un pis-aller qui ne remplacera jamais la parole vivante. La vraie formation est toujours orale, parce que seule la parole permet le dialogue. » Il nous semble avoir retrouvé un peu de cette intention psychagogique et pratique dans le manuel de médiation proposé par Camille Roelens, à mi-chemin entre le traité (trop théorique) et le guide (souvent trop rigide pour être adaptable aux situations concrètes).
L’ouvrage, donc, est d’assez petite taille, comme il convient pour un manuel, sans que son volume soit pour autant négligeable : 88 pages de texte complétées par plusieurs annexes et parsemées de synthèses et d’encarts culturels et illustratifs. Après un avant-propos et une introduction exposant clairement le projet rédactionnel, le texte est découpé en trois parties principales. La première situe la question de l’autorité au sein des problématiques générales des sociétés humaines, plus particulièrement dans le contexte des démocraties contemporaines, marquées par une autonomie individuelle pouvant aller, selon Marcel Gauchet, jusqu’à opérer un « retournement » de la démocratie contre elle-même (Gauchet, 2002). En effet, les analyses de Gauchet, reliées de façon patente à celles d’Hannah Arendt, sont le filigrane initial de certaines investigations de Roelens. Celui-ci, tout en prenant acte de la quasi-disparition de l’autorité traditionnelle, travaille avec l’idée de la nécessité d’une autorité actualisée comme élément nécessaire pour « fluidifier » et viabiliser les rapports sociaux à l’heure de l’autonomie individuelle et collective. « Le rôle-clé de l’autorité est d’une certaine façon de fluidifier le fonctionnement d’un certain nombre de relations et de mécanismes au sein des sociétés humaines. L’autorité ne fixe pas le but de la vie sociale, elle se met à son service. » (p. 23) Il s’ensuit qu’il s’agit ici d’une autorité appelant à une posture « de service » et non « de commandement » (p. 77), ce qui la distingue fondamentalement de l’autorité des Anciens. C’est ainsi que Roelens propose de découpler la notion d’autorité de celle de pouvoir, afin de miser sur l’indispensable consentement de ceux qui reconnaissent diverses formes d’autorité dans leur vie quotidienne, à l’âge démocratique. C’est donc bien parce que l’autorité doit fonctionner sur le mode de l’influence légitime, et non sur celui de la puissance (moins compatible avec le paradigme de l’autonomie individuelle) qu’elle constitue une question-clé de la substance sociale démocratique. Pour traiter cette dimension, l’auteur s’en remet alors, entre autres, aux travaux de Philippe Foray (2016) sur le « devenir-autonome ».
Une fois établi ce lien contextuel entre autorité, autonomie et démocratie, la deuxième partie se consacre à la compréhension de l’autorité, afin d’en établir une définition. Comme de nombreux auteurs avant lui, Roelens aborde ce chantier conceptuel par la négative, en écartant d’abord ce que l’autorité n’est plus ou n’est pas : une structure relationnelle traditionnelle incitant fortement à l’obéissance envers les « supérieurs » sociaux. Selon lui, l’autorité n’est donc ni le pouvoir (qui contraint), ni la domination (qui enferme dans une hiérarchie sociale, de genre, etc.), ni le droit (qui définit le légal, non le légitime), ni la violence, la puissance ou la menace (qui nient l’autonomie du sujet), ni la manipulation (qui trompe), ni l’autoritarisme (qui interdit la résistance autonome). L’autorité libérale – en contexte individualiste – doit fonctionner, en fait, comme un indispensable complément de l’action du pouvoir et du droit. Elle suppose la reconnaissance de sa légitimité et un consentement pleinement autonome et rétractable, ce qui lui permet de dessiner des relations d’influence pacifique, là où le pouvoir et la loi, in fine, s’appuient aussi sur un volet coercitif. Pour l’auteur « agir par autorité, donc par influence sans contrainte, est possible lorsque ce qui est proposé […] est perçu non pas tant comme légal mais bien avant tout comme légitime. » (p. 53) On retrouve ici la conception de l’autorité comme « surpouvoir » chez Alain Renaut (2004), autre référence présente dans ces analyses. Relevons d’ailleurs une difficulté conceptuelle fréquente : comme beaucoup d’auteurs, Roelens utilise l’étymologie du concept d’autorité (augere) pour valoriser une éventuelle « fonction d’augmentation » (p. 59) qui permettrait à l’autorité de prodiguer des bénéfices à ceux qui en reconnaissent la légitimité. Il nous semble au contraire que cette étymologie indique que l’autorité augmente plutôt le pouvoir de celui qui la détient et donc qu’elle est bien ce « sur-pouvoir » dont parle Renaut. En ce sens, même un régime peu démocratique et/ou illibéral voudrait renforcer son emprise coercitive par la reconnaissance supplémentaire de la légitimité de son autorité, en persuadant la population de consentir à lui obéir pacifiquement.
La deuxième partie passe aussi peut-être un peu vite sur une autre difficulté définitionnelle : l’autorité serait « un moyen d’avoir une influence sur quelqu’un sans avoir à lui imposer ses actions » (p. 18). Soit. Mais dans ces conditions, qu’est-ce qui différencie l’autorité des autres formes d’influence ou de manipulation ? En plein règne des influenceurs sociaux prodiguant mille et un conseils dans des domaines variés, au cœur de l’époque de la « fabrication du consentement » (Chomsky et Herman, 2008) par les médias dominants, qu’est-ce qui pourrait faire la spécificité de l’autorité « démocratique », sinon la recherche d’un consentement lucide, rationnel, critique, obtenu par la réflexion et l’information, et dans le refus de l’effet envahissant des réseaux sociaux ? Si l’autorité ne doit plus, ne peut plus fonctionner sur un mode hypnotique (Durkheim) ou charismatique (Weber) institutionnel, autrement dit en anéantissant en quelque sorte la volonté individuelle, alors elle doit se donner les moyens d’en appeler authentiquement à la conscience critique du sujet et à la volonté lucide que pourraient lui apporter une pratique raisonnée des médias critiques et un débat public pluraliste et équitable. C’est là tout le problème – bien ambitieux – de la formation du jugement et de l’éducation aux médias, lesquelles seraient les meilleurs supports pour l’émergence de cette « culture générale de l’autorité » dont l’auteur voudrait doter les citoyens démocratiques. Il nous semble que ce point pourrait constituer un prolongement de l’argumentation (ce qu’indique d’ailleurs la conclusion), surtout à l’heure de la post-vérité et de l’incessante guerre de l’opinion. Une remarque parallèle peut souligner que l’avènement contemporain de la « société du contrôle » (Deleuze, 1986) semble désactiver par avance une bonne partie de cette autorité consentie que les penseurs libéraux pensent pouvoir aisément opposer aux régimes autoritaires ou totalitaires.
La troisième partie traite de l’exercice de l’autorité comme médiation et influence interindividuelles consenties. Roelens y complète le profil de celle-ci en cumulant des éléments susceptibles d’en asseoir la légitimité : explicitation du cadre, confiance et crédibilité, bienveillance, reconnaissance individuelle réciproque, ou encore épaisseur éthique. On est loin des « recettes » et des « kits de survie » parfois proposés comme des panacées, notamment dans le monde enseignant. Il s’agit plutôt ici de combiner et d’articuler différents principes pour les postures et les gestes relationnels, dans un esprit général d’adaptation permanente. En une saisissante formule, l’auteur rappelle d’ailleurs que « l’éthique est le domaine des arbitrages qui n’ont rien d’évident et des zones grises de l’hésitation ». (p. 79) Sur ce point, l’univers démocratique semble inviter à une retenue morale (le minimalisme éthique) et à un redéploiement de la morale dans la sphère du Juste – et non plus dans celle du Bien. On reconnaît là des propositions d’esprit libéral en vue d’une « autorité bienveillante » dont l’existence nous semble quand même relever aussi et surtout de l’idéal perpétuel, quand il ne s’agit pas tout bonnement d’un leurre idéologique posé sur la violence matérielle des rapports sociaux.
In fine, cet ouvrage vise opiniâtrement à éclairer les questions liées à la « démocratisation de l’autorité » (p. 85) et à projeter le lecteur vers leur application à quelques questions vives de nos sociétés. Dans celles-ci, la maximalisation des propositions existentielles (caractéristique de la modernité démocratique) s’accompagne de la minimalisation des impositions morales, juridiques, normatives, ce qui devrait inciter la démocratie à créer sans cesse (entre autres par l’éducation et la formation du citoyen) les conditions des « consentements obligatoires » (p. 93) sans lesquels on ne saurait parler d’autorité au sens strict du terme. Il n’est pas du tout sûr que les démocraties dites « libérales » en prennent le chemin, tant ce modèle s’articule difficilement avec les tendances hégémoniques du néolibéralisme économique, politique et culturel. Rendons toutefois grâce à l’auteur, qui maintient ouverte une perspective constructive pour prendre la démocratie à ses propres mots.
On apprécie donc la tentative de Roelens et sa contribution au débat, d’autant plus qu’il propose quelques annexes propres à alimenter la poursuite de la discussion : une « FAQ de l’autorité », un glossaire, une médiathèque et une bibliographie assez complète, même si certaines critiques de l’autorité (par exemple : Houssaye, ou les pédagogies libertaires) et certaines tentatives non-directives de l’Éducation Nouvelle en sont absentes – il est vrai que l’auteur ne s’est pas cantonné à la sphère de l’éducation. Voilà en tout cas un ouvrage apportant honnêtement sa contribution à la réflexion collective sur la forme de vie promise, mais pas toujours permise, par la démocratie dite libérale.
Bibliographie
Chomsky, N., Herman, E.-S. (2008). La Fabrication du consentement : de la propagande médiatique en démocratie [1988]. Agone.
Deleuze, G. (1986). Foucault. Minuit.
Foray, P. (2016). Devenir autonome. Apprendre à se diriger soi-même. ESF.
Gauchet, M. (2002). La démocratie contre elle-même. Gallimard.
Hadot, P. (2002). Exercices spirituels et philosophie antique. Albin Michel.
Houssaye, J. (2007). Autorité ou éducation ? Entre savoir et socialisation : le sens de l’éducation. ESF
Renaut, A. (2004). La fin de l’autorité. Gallimard.
Roelens, C. (2019). L’autorité bienveillante dans la modernité démocratique, entre éducation, pédagogie et politique [Thèse de doctorat inédite en sciences de l’éducation], Université de Lille, France.
Processus et finalités de la professionnalisation. Comment évaluer la professionnalité émergente ?
Auteurs : Christophe Gremion et Cathal de Paor (Dir.), De Boeck, 2021, 314 pages, ISBN :978-2-8073-3264-5
Par Thérèse Perez-Roux, Université Paul Valéry Montpellier, France
 L’ouvrage « Processus et finalités de la professionnalisation. Comment évaluer la professionnalité émergente ? », publié aux éditions de Boeck en 2021 sous la direction de Christophe Gremion et Cathal de Paor, mobilise un ensemble de contributions issues de deux symposia ; le premier organisé dans le cadre du colloque ADMEE Europe (janvier 2020), le second organisé au sein du colloque du gEvaPP (février 2020). Lors de ces rencontres, les auteurs et autrices de cette publication ont participé, à partir de regards pluriels, à une réflexion commune autour d’une question complexe à appréhender : comment évaluer la professionnalité enseignante ?
L’ouvrage « Processus et finalités de la professionnalisation. Comment évaluer la professionnalité émergente ? », publié aux éditions de Boeck en 2021 sous la direction de Christophe Gremion et Cathal de Paor, mobilise un ensemble de contributions issues de deux symposia ; le premier organisé dans le cadre du colloque ADMEE Europe (janvier 2020), le second organisé au sein du colloque du gEvaPP (février 2020). Lors de ces rencontres, les auteurs et autrices de cette publication ont participé, à partir de regards pluriels, à une réflexion commune autour d’une question complexe à appréhender : comment évaluer la professionnalité enseignante ?
De fait, l’ouvrage met en perspective les enjeux de la professionnalisation, située du point de vue de la construction ou du développement de la professionnalité et en lien avec différentes formes d’évaluation, dans divers contextes de formation. Les contributions s’intéressent principalement au monde de l’enseignement, tout en élargissant aux professions adressées à autrui (chapitre 3 par exemple). Elles proposent d’explorer par des objets et des démarches spécifiques, diverses dimensions, méthodes, moyens et indicateurs permettant de rendre compte de la professionnalisation des individus et des collectifs.
Dès l’introduction, les coordonnateurs positionnent le projet en lien avec « les évolutions du monde du travail (employabilité, compétitivité et concurrence dans un contexte de mondialisation), avec le besoin de reconnaissance des branches professionnelles (défense des droits et acquis des travailleurs) ou encore avec le besoin de réalisation voire d’émancipation des personnes (autonomie, responsabilisation personnelle et développement d’une posture critique et réflexive) (p.5). Cette approche s’inscrit dans les trois sens de la professionnalisation (Gremion, 2021 ; Wittorski, 2014) : professionnalisation-profession, professionnalisation-efficacité du travail et professionnalisation-formation. Si la construction de la professionnalité renvoie à diverses ingénieries de formation (port folio, APP, etc.) qui valorisent la réflexivité des formés, il s’agit par ailleurs de s’intéresser aux savoirs théoriques à et pour enseigner, ainsi qu’aux savoirs sur et de la pratique (Altet, 2008, Piot, 2009). Ces derniers, considérés comme pluriels, composites, hétérogènes et situés, nécessitent la prise en compte du réel de l’activité et de ce qui se joue pour le sujet confronté aux attentes de l’évaluation, à la vision idéalisée d’un professionnel (en devenir). La dimension critique de l’évaluation est ainsi mobilisée pour éviter de réifier les processus de construction de la professionnalité dans l’espace-temps de formation initiale ou, pour permettre aux professionnels de s’inscrire dans un développement continu attestant d’une professionnalité en mouvement. Un ensemble de questions concernant les critères, les indicateurs, les référentiels de compétences pointe le risque normatif de l’évaluation et met en perspective le contenu des différentes contributions.
Dans une orientation philosophique, Adda Meharez Frey initie le propos et convoque l’approche kantienne pour aborder la professionnalisation dans une tension permanente entre soumission et exercice de la liberté. Pour l’auteur, le professionnel est celui qui, au-delà des compétences reconnues qu’il peut mobiliser, « sait y faire » dans des situations non stabilisées. Une « pédagogie de la phronesis » est mise en avant avec, en corollaire, le développement du jugement ; elle s’inscrit dans une perspective compréhensive visant, in fine, autonomie et émancipation des sujets.
L’ouvrage est ensuite structuré en trois sections. La première partie porte sur des manières directes ou indirectes d’aborder les processus d’évaluation. Dans une approche philosophique Alban Roblez interroge « ce qu’il y a d’herméneutique dans l’évaluation ». En rendant compte des « mouvements » opérées lorsqu’il s’agit d’expliquer-comprendre-interpréter, l’auteur examine les tensions entre les textes qui cadrent l’observable et le sens donné à la situation par les différents sujets concernés. La réflexion conduite autour de l’interprétation et de la subjectivité ouvre sur la dimension éthique de l’évaluation.
Dans la contribution suivante, Nicolas Fernandez et Nicolas Gulino s’intéressent au développement de la compétence de collaboration interprofessionnelle en santé (Canada) à partir d’une entrée par la clinique de l’activité. Face à l’utilisation, en formation, de référentiels de compétences comportant des indicateurs décontextualisés et peu descriptifs lorsqu’il s’agit d’évaluer cette compétence, les auteurs proposent de mettre en lumière, par l’observation – et de prendre appui sur – les savoirs expérientiels des professionnels pour développer des indicateurs valides et crédibles. Ainsi, les parcours de développement de cette compétence pourraient s’adosser à des « gestes, actions, réflexions, comportements observables » relevés au sein de situations jugées emblématiques dans les équipes de soin.
Amandine Huet, Marc Labeeu, Alexandra Paul et Catherine Nieuwenhoven étudient la transition professionnelle d’adultes en reprises d’études en Belgique francophone. En interrogeant le bien-être et la satisfaction des besoins de soutien dans la phase d’insertion professionnelle des enseignants, ils tentent de montrer dans quelle mesure cela favorise la construction de la professionnalité. Le choix d’entrer par un des cinq besoins de soutien repérés par Carpentier (2019), lié à la socialisation organisationnelle, sur la base de trois cas contrastés (un étudiant en formation initiale-FI, deux étudiants en insertion professionnelle-IF), conduit les auteurs à souligner l’importance de dispositifs réflexifs pour accompagner et soutenir l’entrée dans le métier. La familiarisation au fonctionnement et à la culture de l’établissement (FI) ou au nouvel environnement de travail (IP), la connaissance des attentes et l’intégration dans les équipes seraient alors des indicateurs de réussite du processus de socialisation.
La dimension réflexive de l’accompagnement est largement mise en avant par Cathal de Paor qui positionne l’évaluation formative de la professionnalité émergente comme un moment fort de l’accompagnement. A partir de travaux déjà conduits sur les interactions tuteurs-stagiaires, l’auteur se centre sur la manière dont l’accompagnateur favorise, chez l’enseignant novice, à la fois la mobilisation de savoirs enseignants et le savoir analyser. Des indicateurs de professionnalité sont repérés chez un enseignant débutant, en capacité d’analyser sa pratique (recul réflexif), d’utiliser des ressources internes et externes adaptées pour développer ses compétences et d’opérer des réajustements suite aux interactions avec le tuteur. L’accompagnement professionnel suppose par ailleurs des enjeux de reconnaissance entre accompagnateur et accompagné. En ce sens, en permettant de mieux comprendre les besoins de l’enseignant et d’appréhender son niveau de développement, l’évaluation formative serait un support au développement de la professionnalité.
La contribution suivante élargit le propos et prend en considération une composante de la professionnalité rarement abordée, l’émancipation professionnelle des enseignants, envisagée à partir des discours et d’une forme d’auto-réflexivité. Jean-François Marcel et Dominique Broussal rendent compte d’une recherche-intervention conduite dans un collège, avec différents acteurs d’une communauté éducative soutenus par un dispositif Léa. Les résultats indiquent que l’émancipation professionnelle participe aux ancrages cognitifs et identitaires du travail enseignant, tout en comportant une dimension subversive vis-à-vis « de l’approche néolibérale qui sous-tend les fondements de la professionnalité […] et relève essentiellement du modèle comptable de la mesure » (p.122). Les auteurs mettent en avant la mobilisation effective des différents acteurs dans le processus d’évaluation à partir d’une démarche participative (recherche-intervention) qui permet d’accéder à de nouvelles formes de légitimité et de reconnaissance, avec, à terme, un développement du pouvoir d’agir. La compréhension des processus de la professionnalisation, organise la deuxième partie de l’ouvrage. A partir d’entrées théoriques et méthodologiques différentes, les auteurs abordent des objets favorisant cette compréhension, en vue d’en faciliter l’évaluation.
Tout d’abord, la contribution d’Isabelle Vivegnis (Québec) s’intéresse aux effets perçus de l’accompagnement sur le développement de l’autonomie professionnelle de l’enseignant débutant, entendue comme un indice de professionnalité. Les participants de 4 dyades (accompagnateur-enseignant novice) rendent compte du processus conduisant à cette autonomie progressive qui nécessite : l’appui sur/l’apport/la mobilisation de ressources plurielles, diverses formes d’encouragement/de soutien pour agir, une aide à la réflexion sur l’action et le respect de principes fondamentaux (liberté, indépendance) en cohérence avec les valeurs personnelles de l’enseignant. Cette approche interroge la posture de l’accompagnateur et la nécessité, pour lui, de trouver sa juste place afin de favoriser la prise d’autonomie de l’enseignant en devenir. Elle ouvre potentiellement sur des repères permettant d’évaluer cette dimension de la professionnalité.
C’est à partir de la perception croisée de stagiaires et de formateurs belges inscrits dans un dispositif d’accompagnement au sein d’un master en sciences de l’éducation, que Pascalia Papadimitriou, Marc Blondeau, Agnès Deprit, Amandine Huet, Olivier Maes, Alexandra Paul, et Catherine Van Nieuwenhoven entendent saisir des indices de professionnalisation. Pour les auteurs, celle-ci relève d’un processus complexe dans lequel se construit la professionnalité, repérable à travers le développement d’une identité et de compétences professionnelles. La contribution se centre sur un stage d’approfondissement et s’appuie sur deux focus group conduits avec chaque groupe d’acteurs pour faire émerger les indices de professionnalité (vocabulaire utilisé pour rendre compte de l’expérience, transactions identitaires en termes de projection dans le métier, phénomènes d’acculturation au milieu professionnel). Des compétences d’analyse réflexive sont mises en évidence et révèlent un processus de transformation pour ce public d’adultes en reprise d’études.
De leur côté, Lorella Giannandrea, Patrizia Magnoler et Fabiola Scagnetti se focalisent sur le développement de la compétence relevant du travail en équipe, essentielle au regard de l’évolution et de la complexité du métier visé. L’analyse de 70 e-portfolio d’étudiants italiens engagés dans un parcours de professionnalisation au métier d’enseignant permettent de repérer les ressources acquises dans ce type de tâche, les processus activés et les changements intervenus. Les auteurs parviennent à identifier des facteurs favorisant le développement de cette compétence transversale (régularité, difficulté de la tâche, type d’organisation, degré de guidage, etc.) Si l’analyse réflexive des étudiants sur l’expérience du travail en équipe est renforcée par l’articulation savoirs pratiques-savoirs théoriques, elle est également soutenue par un dispositif d’auto, de co et d’hétéroévaluation. En ce sens les auteurs donnent un certain nombre de repères tout en s’interrogeant sur le transfert de ces compétences du travail en équipe dans le contexte professionnel.
La contribution de Marcos Maldonado s’intéresse à la place occupée par les théories implicites dans le processus de construction et d’évolution du répertoire didactique des enseignants de langue novices. L’auteur revient sur la difficile articulation entre savoirs théoriques issus de la formation et savoirs socioculturels (croyances, représentations, conceptions personnelles) liés à l’histoire du sujet et à ses processus d’apprentissage. Deux dispositifs de formation proposés à l’université de Buenos Aires (Argentine) s’appuient sur des récits projectifs et rétroprojectifs dont l’analyse met en évidence des systèmes cognitifs hétérogènes qui organisent la réflexion et la prise de décision, tout en participant à l’acquisition de compétences. La prise en compte de ces structures cognitives préexistantes en formation initiale permet de comprendre la construction de la professionnalité enseignante et d’envisager des dispositifs adaptés.
Les contributions de la troisième partie ont pour objet de repérer des indicateurs attestant de la construction de la professionnalité.
À ce titre, Georges Modeste Dabové-Foueko et Raquel Becerril-Ortega prennent en considération les facteurs psychologiques, sociaux et existentiels, ainsi que les dimensions liées au contexte organisationnel, pour repérer les indices d’engagement professionnel dans les pratiques pédagogiques de six enseignants de l’enseignement technique (spécialité électronique) au Cameroun. En utilisant différentes méthodologies (échelle de comportement, analyse de l’activité), les auteurs soulignent l’importance du parcours de formation initiale et la nécessité de prendre en compte les conceptions personnelles des enseignants pour comprendre les degrés d’engagement dans le métier, ouvrant sur la construction d’une professionnalité enseignante.
C’est au croisement de regards sur les normes et les savoirs mobilisés par les stagiaires en enseignement secondaire que Sophie Vanmeerhaeghe interroge le stage comme objet complexe à investir. En effet, dans ce système particulier d’interactions où circulent des savoirs pluriels, l’auteure tente de relever quelques indices communs de professionnalisation en croisant les regards du stagiaire, du maître de stage et des élèves. Pour les stagiaires et les élèves, une place prépondérante est accordée à la construction et au maintien de relations interpersonnelles. Si l’expertise disciplinaire est mise en avant, les compétences pédagogiques et didactiques sont faiblement présentes dans les discours, excepté pour les maîtres de stage qui valorisent également la réflexivité du stagiaire. Ainsi, les normes et savoirs diffèrent en fonction des acteurs, de leur perception du stage et de leur rôle, chacun utilisant ses propres règles et repères pour agir. En ce sens, les indices non partagés en termes de professionnalité peuvent conduire à des formes d’incompréhension et créer des points de tension préjudiciables au processus de professionnalisation.
Dans un dernier chapitre qui fait écho à différentes contributions de l’ouvrage, Christophe Gremion, Veronica Bürgi, Roberto Christian Gatti et Véronique Leroy se donnent pour objectif d’identifier des indicateurs de professionnalisation dans une formation initiale d’enseignants en Suisse. Il s’agit, à terme, d’appréhender l’efficacité de différents dispositifs proposés dans les cursus de formation de trois régions différentes qui bénéficient d’une relative autonomie. En croisant trois approches de la professionnalisation (professionnalisation- profession, professionnalisation-formation et professionnalisation-efficacité du travail) et cinq domaines de professionnalisation (réflexion et discours sur son action, conscience de son identité professionnelle, coopération et collégialité, adaptabilité à la complexité et à la singularité de chaque situation, niveau de maitrise personnelle) les auteurs mettent en lumière un ensemble d’indicateurs. Au regard des résultats produits, ils interrogent les valeurs qui organisent l’éthos professionnel, les processus d’appropriation du genre et les formes de renormalisation (style), ouvrant sur la capacité de l’acteur à « poser un regard éthique sur sa propre pratique » (p. 287).
Richard Wittorski conclut l’ouvrage par un retour sur la question initiale « Comment évaluer la professionnalité émergente ? » et produit une synthèse des différents apports. Cette contribution repositionne les critères, les indicateurs et les finalités de l’évaluation orientées vers le contrôle ou vers le développement. En interrogeant les méthodologies et les difficultés rencontrées dans une perspective évaluative, l’auteur met en garde contre une forme de réification qui pourrait survenir dans la recherche de repères nécessaires à l’évaluation ; il rappelle que l’application de modèles ne peut suffire lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui se joue dans le processus de professionnalisation. Dans un deuxième temps Richard Wittorski met en avant un ensemble de réflexions en lien avec l’ouvrage et dans son prolongement. Il aborde le débat à propos du « travail bien fait » qui peut générer des conflits entre les différents acteurs concernés et relie les indices de la professionnalisation à la prise de conscience de ses pratiques par le sujet agissant. Revenant sur les dimensions incorporées de l’apprentissage professionnel, sur les espace-temps multiples pouvant créer des décalages et des tensions dans le travail, il met en avant la nécessité de prendre en compte les contextes pour évaluer la professionnalité.
Ainsi l’ouvrage dirigé par Christophe Grémion et Cathal de Paor traite, à partir d’une approche plurielle, une question vive dans le champ de la formation : l’évaluation de la professionnalité émergente avec, en arrière-plan, un questionnement amorcé avec les travaux de Bourdoncle (1991) sur les processus et finalités de la professionnalisation. L’émergence ou le développement de la professionnalité est envisagé dans différents contextes : formation initiale, entrée dans le métier ou étapes plus avancées de la carrière professionnelle.
La dimension internationale de l’ouvrage se révèle très stimulante. En effet, les travaux mobilisés ont été conduits dans différents pays (Belgique, Canada, France, Italie, Suisse, Argentine, Cameroun) et à partir d’un éventail large de méthodologies et de cadres théoriques. Si ce large balayage crée une dynamique de réflexion intéressante et montre l’intérêt de tels travaux, il amène parfois un effet de flou dans les concepts mobilisés, notamment entre professionnalisation et professionnalité qui auraient gagné à être davantage stabilisés. Un appui sur les travaux de Bourdoncle (1991, 2000) aurait sans doute permis de repositionner la professionnalité comme l’un des trois processus de la professionnalisation. De façon complémentaire, un adossement aux travaux de Wittorski (2007), aurait davantage pris en considération les transactions entre intention de professionnalisation et développement professionnel des sujets se formant. Enfin, au-delà de la place accordée aux savoirs et aux compétences dans ce processus complexe qui consiste à se construire comme professionnel, existent de forts enjeux identitaires (Perez-Roux, 2012) sur lesquels les contributions reviennent assez peu. D’autres travaux répondant à des préoccupations en partie identiques auraient également permis d’ancrer ou de prolonger la portée de l’ouvrage (Vanhulle, 2009 ; Lantheaume et Simonian, 2012; Jorro, Brocal et Postiaux, 2013 ; Bodergat, Wittorski et Wentzel, 2020).
Au-delà de ces remarques, l’ouvrage éclaire d’inévitables tensions dans l’évaluation de la professionnalité émergente au sein d’un processus de professionnalisation en partie opaque. Les rapports entre subjectivité/objectivation, normativité/émancipation sont ainsi questionnés. Par ailleurs, certaines contributions permettent de confronter ce qui relève d’une démarche inductive (exploratoire) ou déductive (critériée) lorsqu’il s’agit de penser puis de mettre en œuvre les conditions d’une évaluation de la professionnalité. Enfin, entre élargissement des approches pour saisir ce qui s’y joue et recherche de cohérence autour d’une approche plus unifiée de la complexité, se jouent des transactions multiples entre acteurs et système (institution, organisation) dans lequel des logiques parfois concurrentes sont à l’œuvre, nécessitant de repositionner, pour soi et avec les autres, les enjeux et finalités de la professionnalisation, dans une perspective critique.
Bibliographie :
Bodergat, J-Y ; Wittorski, R., Wentzel, B. (2020). L’évaluation de la professionnalisation dans la formation des enseignants. Démarches et faces cachées. Recherche et formation, 93, 9-15
Bourdoncle, R. (1991) Note de synthèse : La professionnalisation des enseignants : analyses sociologiques anglaises et américaines, Revue française de pédagogie, 94(1), 73-91.
Bourdoncle, R. (2000). Autour des mots : professionnalisation, formes et dispositifs. Recherche et Formation, 35, 117-132.
Jorro, A., Brocal, R., Postiaux, N. (2013). Evaluer la professionnalité émergente en formation. De Boeck.
Lantheaume, F et Simonian, S. (2012) La transformation de la professionnalité des enseignants : quel rôle du prescrit ? Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol. 45(3), 17-38.
Perez-Roux, T. (2012). La professionnalité enseignante. Modalités de construction en formation. Presses Universitaires de Rennes.
Vanhulle, Sabine. (2009). Evaluer la professionnalité émergente des futurs enseignants : un pari entre cadres contraignants et tensions formatives. Dans L. Mottier Lopez et M. Crahay (Dir.) (Ed.), Évaluations en tension : entre la régulation des apprentissages et le pilotage des systèmes, (p.165-181). De Boeck.
Wittorski, R. (2007) Professionnalisation et développement professionnel. L’Harmattan.
Retours gagnants : de la sortie sans diplôme au retour diplômant
Auteur : Bertrand Bergier, Éditions Peter Lang
Par Véronique Bordes, Université de Toulouse 2, France
 Bertrand Bergier, dans cet ouvrage, nous propose, à partir d’une recherche, de mettre en débat la question du retour des jeunes en formation et de leur obtention d’un diplôme après des processus de décrochages scolaires ou des périodes d’interruption plus ou moins longues. L’auteur prend donc le parti d’aller au-delà des constats d’échec scolaire, proposant une compréhension des parcours et des expériences, mettant en lumière ce qui peut être à l’origine du décrochage scolaire et ce qui permet, non pas un raccrochage au sein de structures dédiées, mais bien un « retour gagnant » au sens diplômant, au travers de parcours diversifiés qui permettent aux jeunes de « revenir en arrière ». L’introduction pose le contexte de la recherche et de l’ouvrage. L’auteur revient sur la situation française et la place prépondérante que la société et les employeurs donnent au diplôme. Même de basse qualification, il permet aux jeunes de s’insérer sur le marché du travail. Pour ceux qui ne peuvent justifier d’un diplôme, ils se retrouvent dans des situations d’exclusion sociale, exposés, plus que d’autres, à des problèmes de santé physiques et mentales. De nombreuses recherches explorent le décrochage scolaire, étudiant les dispositifs de raccrochage dont le principe est de ramener les jeunes dans le système scolaire. Pourtant, il existe d’autres voies qui ne sont pas dédiées aux décrocheurs, mais qui permettent à des jeunes de parcours divers d’accéder à la validation d’un diplôme.
Bertrand Bergier, dans cet ouvrage, nous propose, à partir d’une recherche, de mettre en débat la question du retour des jeunes en formation et de leur obtention d’un diplôme après des processus de décrochages scolaires ou des périodes d’interruption plus ou moins longues. L’auteur prend donc le parti d’aller au-delà des constats d’échec scolaire, proposant une compréhension des parcours et des expériences, mettant en lumière ce qui peut être à l’origine du décrochage scolaire et ce qui permet, non pas un raccrochage au sein de structures dédiées, mais bien un « retour gagnant » au sens diplômant, au travers de parcours diversifiés qui permettent aux jeunes de « revenir en arrière ». L’introduction pose le contexte de la recherche et de l’ouvrage. L’auteur revient sur la situation française et la place prépondérante que la société et les employeurs donnent au diplôme. Même de basse qualification, il permet aux jeunes de s’insérer sur le marché du travail. Pour ceux qui ne peuvent justifier d’un diplôme, ils se retrouvent dans des situations d’exclusion sociale, exposés, plus que d’autres, à des problèmes de santé physiques et mentales. De nombreuses recherches explorent le décrochage scolaire, étudiant les dispositifs de raccrochage dont le principe est de ramener les jeunes dans le système scolaire. Pourtant, il existe d’autres voies qui ne sont pas dédiées aux décrocheurs, mais qui permettent à des jeunes de parcours divers d’accéder à la validation d’un diplôme.
L’auteur s’intéresse, dans cet ouvrage, aux trajectoires des jeunes de 16 à 30 ans ayant développés un retour diplômant. La démarche d’enquête articule un récit de parcours scolaire et un questionnaire. Ces recueils de données sont complétés par une pratique restituante qui permet de soumettre les résultats aux enquêtés tout au long de la recherche, permettant d’ouvrir le débat et d’enrichir la production de données.
Les cinq chapitres qui composent l’ouvrage sont organisés comme le parcours que peut suivre un jeune, proposant une analyse qui croise les différentes formes de données recueillies. Ce cheminement réflexif accompagne le lecteur vers une meilleure compréhension des situations qui jalonnent les parcours des jeunes.
Le premier chapitre propose de revenir sur les sorties non diplômantes de l’école. Quels parcours suivent ces jeunes qui se retrouvent hors du système scolaire sans avoir obtenu un diplôme. Les trajectoires scolaires normées par la société ne pensent jamais les sorties plus ou moins prématurées et sans titre. Et si la formation tout au long de la vie est présentée comme possible, paradoxalement, l’irréversibilité du parcours reste la norme dominante.
L’auteur nous propose d’explorer les facteurs de sortie sans diplômes à partir de 215 enregistrements, 215 textes codifiés et 2340 occurrences. Les facteurs les plus fréquents sont ceux que l’on retrouve traditionnellement dans les recherches sur le décrochage scolaire. Cependant, l’auteur va mettre au regard ces facteurs avec le niveau de titre obtenu lors du retour diplômant, ce qui leur donne une nouvelle dimension et permet une évolution dans la compréhension du poids des parcours des jeunes. Le facteur principal, un problème d’orientation, est ainsi revisité montrant comment cette injonction d’un choix professionnel arrive dans des moments du parcours des jeunes qui les laisse dans une incapacité à choisir.
Un autre facteur est le manque de sens donné à la formation qui amène une posture de défiance de la part des jeunes, d’autant plus lorsque les parents ne possèdent pas les codes scolaires ou sont dans l’incapacité d’accompagner leurs enfants dans une poursuite d’étude. Là encore, le contexte social joue un rôle important dans la possibilité de trouver un sens dans la construction des savoirs, un accompagnement dans la méthodologie du travail personnel entraînant un désinvestissement dans le travail personnel.
L’auteur nous propose, à partir des constats qui vérifient les travaux existants une organisation des facteurs repérés en 11 catégories constatant que des « rationalités a priori antinomiques (…) peuvent avoir la même conséquence : une sortie non diplômante du système scolaire » (p49) proposant au lecteur une prudence dans la lecture des résultats. De même il souligne la nécessité d’interroger le retour aux études de jeunes mettant en cause le système scolaire et les enseignants. Il finit cette partie en posant d’une part la question du poids des contextes sociaux dans lesquels évoluent les jeunes, la place du genre dans ces sorties, l’influence du niveau académique lors de la sortie et l’envie exprimée de revenir un jour aux études. Ainsi, l’auteur vérifie la dimension plurifactorielle typique du décrochage déjà constatée dans d’autres travaux et propose de s’interroger sur la période non attendue et non structurée par l’institution scolaire qui suit la sortie sans diplôme.
Le deuxième chapitre propose d’explorer ce que font les jeunes hors les murs de l’école. Les enquêtés caractérisent cette période comme un temps de petits boulots, mais aussi la possibilité de réfléchir à leur parcours. C’est aussi un temps hors d’un rythme normé de la journée qui va faire passer les jeunes de l’activité d’un job, à l’activité de loisirs avec des temps d’oisiveté qui peuvent être appréciés puis redoutés et des temps de remise en question. Cette période est donc comme une parenthèse dans une société dont la norme est d’être en formation ou en emploi. Les expériences professionnelles développées pendant ce temps «hors les murs de l’école » sont présentées comme valorisantes, permettant de développer ou mobiliser des compétences, favoriser du lien social, mais aussi de retrouver un temps structurant. Pourtant, ce temps n’est qu’une parenthèse qui n’ouvre pas, pour les jeunes interviewés, des perspectives d’avenir.
Lorsqu’ils évoquent les périodes d’oisiveté, les jeunes passent d’abord par une vision d’apaisement leur permettant de souffler et de prendre le temps après une période difficile à vivre. Pourtant, ils se retrouvent assez vite désœuvrés, incapables de transformer leur temps libéré en activités. La plupart d’entre eux vont entamer une réflexion sur ce qu’ils pourraient bien faire dans un milieu du travail dans lequel ils ne trouvent pas d’attirance. Ce temps de retour sur soi et ses expériences professionnelles va impulser, chez certains, cette envie de revenir en formation. L’auteur nous montre l’enjeu, finalement, de ce temps de pose qui devient socialisateur et amène les jeunes à vouloir agir, d’autant plus lorsque les jeunes rencontrent des autrui signifiant qui vont l’aider à remettre en cause sa situation. Les jeunes mentionnent aussi l’importance de la continuité des liens familiaux et amicaux qui finalement ont un rôle dans la construction d’un possible retour en formation. L’auteur remarque que les jeunes qui intéressent cette recherche ne rentrent pas dans les parcours classiques de prise en charge. Certains, une minorité, disent conserver un lien avec l’école. La majorité de ces jeunes sont durant cette période de transition, dans des conditions suffisamment sécurisées pour éviter de les voir s’éloigner complètement des fonctionnements institutionnels et normes de la société. Là encore, la profession des parents va influencer le déroulement de cette période, le genre pouvant être disqualifiant, les filles étant plus souvent perçue comme déviantes à une norme scolaire qui pose l’idée qu’elles sont plus sérieuses que les garçons. Enfin, ce temps d’interruption est vécu différemment selon le niveau d’étude.
Finalement, lorsque les jeunes quittent l’école, ils entrent dans un espace et un temps social intermédiaire. Bertrand Bergier nous montre, en interrogeant des jeunes, que cette parenthèse dans le parcours scolaire, peut ne pas être considérée comme un échec, parce que ne correspondant pas aux attendues de la société, mais bien comme un passage permettant aux jeunes de s’interroger sur le sens de leur parcours. Cette discontinuité scolaire ne produit pas des jeunes délinquants, elle est la possibilité, pour les jeunes interviewés, de prendre le temps de réfléchir au sens de la formation et de l’exercice d’une profession. Cette interruption est toutefois socialement marquée mettant en jeu le contexte social, économique et culturel dans lequel les jeunes évoluent, mais aussi le genre et le niveau académique de sortie du système scolaire.
Le troisième chapitre interroge ce qui favorise le retour aux études. L’auteur nous propose l’identification sociologique des profils de jeunes qui retournent aux études, persistent et obtiennent leur premier diplôme après être sortis de l’école depuis au moins 6 mois. Il s’appuie sur un échantillon de 97 hommes et 118 femmes. Il constate que le genre n’est pas, dans sa recherche, une variable significative et que les retours gagnants se font surtout entre 19 et 21 ans. Là encore, le contexte social et la composition de la fratrie ont des effets sur les parcours des jeunes. En effet, le bagage académique des parents influence le retour en formation et le choix du diplôme préparé. L’auteur constate, en explorant le parcours des jeunes, que si le redoublement peut être annonciateur d’échec scolaire, il n’a pas d’influence sur la reprise d’étude et la validation d’un diplôme. Ce retour en formation se fait, le plus souvent, dans le prolongement de la filière abandonnée au premier temps de formation. Pourtant, 45% des jeunes issus de filières générales font le choix de reprendre une filière professionnelle en accord avec le milieu familial. Pour quelques jeunes issus de la filière professionnelle, la reprise se fait en filière générale avec l’intention officielle de prolonger les études dans le supérieur. Enfin si les sorties académiques se font de la 5e à la terminale, elles sont plus fréquentes au niveau de la terminale pour les filières générales et professionnelles. Pour les filières technologiques, les sorties sont plus nombreuses en seconde et première.
L’auteur poursuit en nous montrant comment le retour aux études est plurifactoriel. Parmi l’ensemble des facteurs exprimés par les jeunes, il en explore trois qui apparaissent plus fréquemment : être encouragé par l’entourage amical et familial pour reprendre les études, avoir accès à une formation qui fait sens aux yeux du jeune, voir au-delà du premier diplôme préparé. Ces trois facteurs permettent de mettre en avant la nécessité de penser un accompagnement vers une reprise d’étude collectivement incluant l’entourage du jeune. Ils montrent aussi la nécessité de trouver un sens à sa formation. Pour qu’il y ait sens, il faut connaître. Découvrir une profession nécessite d’avoir les informations suffisantes pour trouver du sens aux enseignements reçus. Ceci demande soit un travail d’information sur les différentes professions, soit un travail de déconstruction des représentations du métier pour avoir une vision proche de la réalité de son exercice. Ces informations peuvent être transmises par des passeurs qui pourront être des personnes de l’entourage direct ou un professionnel à l’occasion d’une rencontre et d’un échange. Peu de jeunes trouvent dans les spécialistes de l’orientation ce rôle de passeur. Les jeunes expliquent aussi leur retour en formation par la vision d’un parcours au-delà du diplôme préparé, qui devient alors un sésame pour un au-delà mobilisateur. Finalement, ce qui facilite le retour gagnant est l’influence de l’autrui significatif qui peut prendre différentes figures selon l’histoire et le contexte du jeune. Le sens, que le jeune prend enfin le temps de saisir, s’ajoute comme facteur de retour gagnant, ce qui facilitera une valorisation autorisant le jeune à entrer en formation et à retrouver une place au sein d’une norme sociétale dont il a été tenu à l’écart, posséder un diplôme. Celui-ci peut alors donner des perspectives de carrières aux jeunes et les entraîner vers d’autres formations et d’autres diplômes.
Le quatrième chapitre étudie ce qui favorise le maintien aux études. Qu’est-ce qui facilite la persévérance scolaire ? L’auteur a identifié 60 facteurs auxquels s’ajoutent 17 facteurs « au long cour » qui rendent possibles le retour et le maintien aux études. Ce sont des facteurs dispositionnels et des facteurs contextuels. Les contenus transmis vont jouer un rôle important dans le maintien en formation, mais aussi les évaluations, les encouragements et l’intérêt que les enseignants portent aux jeunes. Pourtant, c’est toujours la famille et l’entourage amical qui pèsent sur ce maintien. L’auteur reste cependant prudent dans la lecture de ses résultats aussi bien issus des entretiens que des questionnaires. Il propose de regrouper ces facteurs en quatre grands groupes : la célébration d’autrui, la célébration de la formation, la célébration de l’ailleurs et de l’après et la mobilisation de soi. Finalement, les facteurs qui permettent à des jeunes de persévérer dans leur reprise d’étude sont fortement liés, là encore au contexte dans lequel ils se trouvent. Être épaulé par sa famille et ses amis, développer du lien avec les apprenants et les enseignants, trouver le sens des savoirs et s’autoriser à en acquérir en dehors de la formation, pouvoir se projeter dans l’exercice d’une profession au plus près de la réalité accompagne le parcours des jeunes dans ce que certains chercheurs nomment un processus de socialisation professionnel. La persévérance n’est donc pas le seul fait de la personne en reprise d’étude, mais bien multifactorielle, mettant en jeu le contexte, l’organisation, mais aussi les conditions de sécurité dans lesquelles les jeunes vont pouvoir cheminer dans un parcours vers un retour gagnant.
Le cinquième chapitre expose les retours et maintiens avortés. Si pour les deux tiers des jeunes interviewés la première tentative de retour gagnant a été la bonne, un tiers ont dû s’y prendre de deux à cinq fois, ce qui témoigne de la difficulté d’aller au bout d’un tel parcours. Bertrand Bergier explore les différents moments possibles dans le cadre de ces essais sans lendemain. Les premières difficultés se présentent, pour certains, dès l’accès à la formation. Pour d’autre, c’est le maintien en formation qui devient impossible, certains encore, mais peu nombreux, n’obtiennent pas le diplôme. Quelques-uns cumulent les obstacles. Pourquoi, alors certains jeunes transforment leur premier essai alors que d’autres doivent s’y reprendre une ou plusieurs fois ? Les jeunes expriment la difficulté rencontrée face à la pression des adultes souvent portée par une ambition sociale et scolaire qu’ils finissent par s’imposer. Ils ont aussi souvent eu recours à des dispositifs de soutien pendant leur période hors les murs et souffert d’un étiquetage social. Les jeunes peuvent aussi souffrir de problèmes de santé qui les poursuivent lors de la reprise d’étude. Enfin, si la durée d’interruption s’allonge, alors les retours gagnants sont plus difficiles à atteindre. Et si un problème d’orientation se produit, alors la situation devient difficile pour le jeune, d’autant plus s’il a déjà vécu cette expérience. Enfin, la solitude est présentée dans les récits des jeunes comme un obstacle à la réussite.
Les difficultés peuvent donc être nombreuses pour persévérer et aboutir à un retour gagnant. Mais avant d’accéder à ce parcours, les jeunes doivent surmonter des obstacles comme la méconnaissance de l’offre, son inadéquation ou son inaccessibilité. Ce qui rend le maintien difficile, pour les jeunes, est de se retrouver projetés dans une forme scolaire qui les a déjà mis en échec. Il faut, de nouveau, essayer de la comprendre et de l’accepter, même si elle apparaît trop souvent comme enfermante et normalisante. Les difficultés de maîtriser une méthodologie de travail, déjà rencontrées dans le parcours initial, peuvent aussi revenir entraver les jeunes et les maintenir dans une dévalorisation de leur capacité à réussir. Enfin, les jeunes parlent de désillusion face aux terrains d’apprentissage et/ou face aux matières enseignées, ce qui rejoint la question de la connaissance de la profession choisie et de l’orientation. Tous ces obstacles peuvent se manifester de façons différentes en fonction du jeune, de son parcours et du contexte dans lequel il reprend ses études. Mais ce qui apparaît au bout du compte, lorsque les jeunes relisent le récit de leur parcours initial, est la pression des adultes sur la nécessité de réussir, c’est-à-dire de valider un diplôme. Finalement, Éric Flavier (LISEC UR2310, Université de Strasbourg) nous propose de ne pas conclure. Il revient sur l’intérêt de cette recherche et la qualité du travail mené par Bertrand Bergier qui porte un regard qui se veut orienté vers la réussite. Il précise l’intérêt de la méthode d’enquête utilisée associant démarche quantitative et qualitative. Il montre les apports nouveaux de cette recherche qui s’attarde sur une période peu étudiée, le temps du hors les murs de l’école, proposant un portrait des jeunes en capacité de s’inscrire dans un parcours de retour gagnant.
Bertrand Bergier nous offre donc un ouvrage qui nous propose de décaler notre regard sur les jeunes qui ne trouve pas leur place dans les parcours de formation initiale classiques. Il nous montre, comment ces jeunes sont en capacité de persévérer et de réussir, même s’ils doivent passer par des essais non transformés. Il nous explique, à partir des données recueillies auprès des jeunes, les conditions de cette persévérance et de ces retours gagnants. Ce n’est pas prioritairement le lien aux dispositifs institutionnels qui amènent les jeunes vers un parcours de retour en formation. Ce constat est d’autant plus important qu’il permet de montrer que finalement, les jeunes ayant quitté le système scolaire ne peuvent être tous accompagnés de la même façon. Au-delà de l’ensemble des dispositifs existant pour prévenir le décrochage ou raccrocher les jeunes pour maintenir une continuité dans le parcours scolaire, il existe des retours gagnants de jeunes reprenant des études et validant un diplôme en empruntant des chemins qui ne sont pas repérés comme dédiés aux décrocheurs. Le retour aux études est un parcours que la société inscrit dans un processus de formation tout au long de la vie. L’auteur prend le parti d’explorer ces parcours de reprise d’étude comme la possibilité de revenir en arrière, de reprendre le fil de la formation, la rendant alors diplômante.
Éducation esthétique et émancipation : la leçon de l’art, malgré tout
Auteur : Alain Kerlan. Éditions Hermann, Paris (2021).
Par Laurence Loeffel, Université de Paris, CERLIS, France
 Pleinement inscrit dans le champ de la philosophie de l’éducation, le dernier ouvrage d’Alain Kerlan est un ouvrage exigeant, ambitieux, le plus ambitieux peut-être de toutes ses productions. Engagé dans la promotion de l’éducation artistique depuis près de 20 ans, Alain Kerlan a toujours œuvré au plus près des expérimentations réunissant artistes et enseignants, qu’il s’agisse de son engagement de dix années dans le programme lyonnais Enfance, art et langages destiné aux écoles maternelles ou de l’attention portée aux expérimentations de collège. Alain Kerlan n’est jamais loin lorsqu’une école, un établissement scolaire se lancent dans un projet d’éducation artistique. Il n’œuvre en effet pas seulement en faveur de la promesse éducative de l’art, il est aussi pleinement engagé dans la cause de l’école. Une école au service de l’enfance, une école vraiment émancipatrice.
Pleinement inscrit dans le champ de la philosophie de l’éducation, le dernier ouvrage d’Alain Kerlan est un ouvrage exigeant, ambitieux, le plus ambitieux peut-être de toutes ses productions. Engagé dans la promotion de l’éducation artistique depuis près de 20 ans, Alain Kerlan a toujours œuvré au plus près des expérimentations réunissant artistes et enseignants, qu’il s’agisse de son engagement de dix années dans le programme lyonnais Enfance, art et langages destiné aux écoles maternelles ou de l’attention portée aux expérimentations de collège. Alain Kerlan n’est jamais loin lorsqu’une école, un établissement scolaire se lancent dans un projet d’éducation artistique. Il n’œuvre en effet pas seulement en faveur de la promesse éducative de l’art, il est aussi pleinement engagé dans la cause de l’école. Une école au service de l’enfance, une école vraiment émancipatrice.
Avec ce dernier opus, l’exigence s’approfondit du côté d’une entreprise de fondation de l’éducation artistique à travers l’expérience esthétique. Ainsi l’éducation artistique en milieu scolaire est-elle approchée de manière constamment critique, ses évolutions et ses développements depuis plus de vingt ans conduisant au constat qu’on est passé à côté de l’essentiel. Questionnant l’actuel consensus politique autour de l’éducation artistique et culturelle, autrement dénommée « EAC », Alain Kerlan en interroge immédiatement les contours : mais sur quoi s’accorde-t-on ainsi ? Sur quelles valeurs ? Pourquoi cette promotion de l’art au rang de « bien éducatif consensuel » ? Alors même que l’EAC, comme l’auteur le montre sans complaisance, est prise dans un réseau de multiples justifications extérieures à l’art (réduction des inégalités, citoyenneté, épanouissement personnel, cohésion sociale, réduction de la violence, etc.), prise aussi entre deux dérives, l’engrenage consumériste au nom de la démocratisation culturelle d’un côté, la scolarisation et la didactisation de l’autre.
Bref, si l’entreprise de (re)fondation de l’expérience esthétique est nécessaire, c’est précisément parce que l’éducation artistique en milieu scolaire est en proie à des dérives qui ont pour effet l’oubli de l’art en tant que tel, l’effacement de sa promesse émancipatrice.
Il faut donc revenir aux fondamentaux et rappeler la leçon de l’art avec Schiller, Hannah Arendt, John Dewey, Donald Winicott, mais aussi Luc Boltanski et Eve Chiapello, Michel Foucault, Jacques Rancière ou Jean-Marie Schaeffer, entre autres. La liste est longue de tous les philosophes, penseurs mobilisés par Alain Kerlan pour redessiner les contours d’une expérience et d’une éducation esthétiques préservant la valeur absolue de l’art. Le but est de « rendre l’art à lui-même, afin d’en préserver le potentiel éducateur ». Pour être éducateur, l’art n’a pas à être vassalisé, asservi à des finalités étrangères. Sa virtu éducative est sui generis. C’est ce que l’ouvrage s’emploie à démontrer.
Cela passe par la nécessité de tordre le cou à quelques préjugés, les plus tenaces, ceux qui font obstacle à la prise en compte sans réserve de l’expérience esthétique. La dissociation entre cognition et émotion est de ceux-là. Alain Kerlan le démontre de façon tout à fait magistrale, « l’art pense » (1ère partie, chapitre IV). « Cette assomption de l’art au penser ne se limite pas à la littérature ; elle s’effectue tout autant, il faudrait dire surtout, dans toutes les formes d’expression qui ont pour matériau non la parole, mais le corps, mais le geste, mais les images et les couleurs, les mouvements et les sons. C’est bien alors de la venue du sensible à l’intelligible qu’il est question, ou mieux, d’une forme d’intelligibilité inhérentes aux mises en forme du sensible » (p. 74). La démonstration requiert encore de récuser plus largement les dualismes du sensible et de l’intelligible, elle exige également de restaurer le continuum entre expérience ordinaire et expérience esthétique, et c’est ici la leçon de Dewey qui s’impose. Pour toutes celles et ceux qui sont familiers de l’école, qui souvent constatent avec impuissance à quel point elle se fourvoie dans son ambition d’éducation artistique et culturelle, ces démonstrations sont très précieuses. Elles permettent de remettre l’art au centre de toutes choses. L’art, la sensibilité, les droits du visible non réduit au dicible, les droits de l’expérience subjective singulière, unique et pourtant partageable. Les droits du plaisir esthétique. L’art est émancipateur, pas seulement parce qu’il nous met en relation avec le monde, mais aussi parce qu’il nous met en relation avec nous-mêmes.
Avec Schiller, au XVIIIe siècle, Alain Kerlan le rappelle, était philosophiquement fondée la nécessité d’une éducation esthétique de l’homme, chemin de la liberté. Avec Schiller étaient établis les principes fondamentaux de l’éducation esthétique de l’homme, comprise comme la seule éducation éduquant pleinement, totalement, la seule capable d’accomplir le destin complet de l’homme.
Il faut reprendre le projet de fondation anthropologique de l’expérience esthétique, estime l’auteur, parce que cette fondation est la seule boussole dont nous disposons pour savoir si nous sommes engagés dans une expérience esthétique authentique et les enfants avec nous, et non dans un simulacre. Le chapitre consacré à ce projet est en ce sens particulièrement lumineux (2ème partie, chapitre VII). La justification anthropologique, on la trouve dans la nature même de l’expérience esthétique qui ne s’identifie pas à un rapport aux œuvres, fussent-elles le patrimoine immortel de l’humanité, mais dans une « conduite singulière, une manière d’être au monde, une attitude face aux choses, aux êtres, sans lesquelles ces œuvres elles-mêmes comme la nature très particulière de la rencontre et de la relation que nous avons avec elles ne seraient tout simplement pas possibles » (p.155). L’expérience esthétique est la condition de possibilité de l’éducation par l’art et à l’art.
Dérouler le fil de cette expérience nous conduit aux constats authentifiés par Alain Kerlan, la nécessité de préserver les hétérotopies (chapitre VIII), d’accepter le potentiel esthétique de l’expérience la plus ordinaire, leur pouvoir émotionnel, la vertu émancipatrice de l’art en tant que tel.
Il faut prendre l’éducation par l’art au sérieux. C’est ce à quoi nous invite Alain Kerlan avec cet ouvrage qui est aussi une forme de résistance.
Un avenir problématique. Éducation et responsabilité d’après Hans Jonas
Auteur : Michel Fabre. Éditions Raison et Passions, Dijon (2021).
Par Camille Roelens, INSPE-HDF, Université de Lille, CIREL, associé ECP, collaborateur CREN, Lille et Nantes, France
 Le nom d’Hans Jonas, philosophe juif allemand dont l’existence recouvre à peu de chose près le XXe siècle (1903-1993), est souvent associé : 1° à sa publication en 1979 du best-seller philosophique de ce siècle (p. 12), Das Prinzip Verantwortung (Le Principe Responsabilité) ; 2° au principe de précaution, que ses thèses auraient inspiré (p. 157). « Un peu court », semble nous dire en creux Michel Fabre dans ce beau livre. Il s’y attache donc : 1° à restituer l’œuvre philosophique de Jonas dans toute son ampleur, sa nuance et sa complexité ; 2° à montrer comment cette même œuvre ne saurait se réduire à la lettre d’un texte donné, mais est bien porteuse, pour qui fait l’effort d’y entrer, de tout un esprit de nature à nous aider à appréhender un avenir problématique.
Le nom d’Hans Jonas, philosophe juif allemand dont l’existence recouvre à peu de chose près le XXe siècle (1903-1993), est souvent associé : 1° à sa publication en 1979 du best-seller philosophique de ce siècle (p. 12), Das Prinzip Verantwortung (Le Principe Responsabilité) ; 2° au principe de précaution, que ses thèses auraient inspiré (p. 157). « Un peu court », semble nous dire en creux Michel Fabre dans ce beau livre. Il s’y attache donc : 1° à restituer l’œuvre philosophique de Jonas dans toute son ampleur, sa nuance et sa complexité ; 2° à montrer comment cette même œuvre ne saurait se réduire à la lettre d’un texte donné, mais est bien porteuse, pour qui fait l’effort d’y entrer, de tout un esprit de nature à nous aider à appréhender un avenir problématique.
L’introduction (p. 11-25) permet à l’auteur – spécialiste de Dewey, Bachelard, Meyer et de la problématisation – d’expliciter les conditions d’entreprise de son étude : « la rencontre avec Jonas était à peu près inévitable puisque son questionnement rejoint […] la problématicité du monde, et ceci de façon radicale, puisqu’il s’agit de sa fragilité ontologique et même de son effondrement possible » (p. 15). Prométhée désormais déchaîné par le degré de maîtrise technique de l’humanité est la cause de ce possible inédit, et l’horizon de l’œuvre jonassienne est de chercher ce qui, au-delà d’une simple maxime prudentielle, « permettrait de ré-enchainer Prométhée à son rocher » (p. 22).
La première partie, « Vie et responsabilité » (p. 27-28) met les fondements et pierres de touches de la proposition philosophique jonassienne. Le premier chapitre s’intitule « la valeur de la vie » (p. 28-50). L’entrée en matière est hardie, car elle assume de violer la fameuse loi de Hume (p. 30-32) qui interdit de déduire le devoir-être de l’être. Au contraire, pour Jonas, la vie à une valeur objective en soi, et en son sein « l’homme apparaît comme la créature vivante la plus perfectionnée, le produit le plus réussi de l’évolution, mais il n’est le résultat d’aucun plan divin, d’aucun dessein intelligent » (p. 48). Il est donc responsable de préserver la vie en général – fin qui elle-même a une valeur en soi -, mais en son sein la vie pleinement humaine en particulier.
Le chapitre suivant établit donc la manière dont la pensée de Jonas se construit « contre la gnose » (p. 51-72), comprise à la fois comme moment de l’histoire de la pensée et tentation planant sur l’entreprise philosophique jusqu’à nos jours. Celle-ci est marquée par un fort acosmisme, c’est-à-dire la conviction que l’ici-bas n’est qu’un « monde hostile et mauvais dont l’homme doit s’affranchir pour devenir lui-même » (p. 54). Un moment de bravoure de cette traversée des études de Jonas sur la gnose est de montrer comment il l’opère avec les outils de l’heideggerianisme pour ensuite les retourner contre ce dernier et montrer qu’il est, à sa manière, une manière de continuer à mépriser « le phénomène de la vie et […] la naturalité de l’homme » (p. 60) par d’autres moyens. Les utopies des lendemains qui chantent au prix des sacrifices présents sont, pour Jonas, justiciables des mêmes critiques.
Le troisième chapitre présente ce qui sans doute constitue la dimension de la pensée de Jonas la plus ancrée dans ce que serait une culture générale de l’histoire des idées, à savoir « l’éthique de la responsabilité » (p. 73-87). Il importe en effet de comprendre que la perspective jonassienne n’est pas prudentielle mais impérative : l’humanité a pour lui l’interdiction morale de se faire disparaître, et donc la responsabilité et le devoir de se préserver. Pour fonder ces obligations, Jonas en passe par une phénoménologie de la parentalité (p. 76-80) – qui commande de prendre soin d’un être vivant vulnérable que l’on a engendré – avant de l’étendre aux espaces politiques de l’existence. Ce dernier point n’est pas sans soulever un certain nombre de questions, et Fabre retrace en particulier les polémiques de Jonas avec son amie Arendt dont on sait à quel point elle réprouvait ce type de transferts.
À l’ombre de l’assimilation du Père et du chef d’État croit en effet le risque paternaliste. « Le paternalisme et ses embarras » (p. 88-99) sont donc au cœur des discussions des thèses jonassiennes dans le quatrième chapitre. Mobilisant l’« argument du capitaine » (p. 89), autrement dit les vertus du couple ordre/obéissance sans délibération comme planche de salut dans les situations critiques, Jonas envisage en effet – quoique prudemment – le recours à quelque tyrannie bienveillante et suspension de la démocratie libérale face à la gravité des enjeux environnementaux. Appliqués à l’éducation, prévient cependant Fabre, de tels principes risquent de conduire à discipliner et moraliser les enfants sans assez les cultiver et développer chez eux prudence et esprit critique, ce qui serait contestable. Fabre conclut (p. 100-103) ainsi cette partie en insistant sur le principe jonassien selon lequel « il est inscrit dans la vie elle-même que l’être vaut mieux que le non-être, que l’être et le bien coïncident » (p. 100), et donc que l’exigence du rapport responsable au monde en découle.
La deuxième partie s’intitule « Technique, Politique Écologie » (p. 105-181), et conduit l’auteur à faire dialoguer Jonas d’autres fortes pensées contemporaines sur ces trois thèmes. Le cinquième chapitre est dédié à « la question de la technique » (p. 106-117). Il montre comment la philosophie jonassienne se nourrit de la pensée heideggérienne de la technique – qui la comprend comme summum de la métaphysique et de l’oubli de l’Être et non comme moyen axiologiquement neutre des fins humaines – tout en s’en écartant. Pour Jonas, la technique n’est pas à inscrire dans une monumentale histoire de l’Être sur laquelle l’homme ne saurait avoir prise, mais « dans l’évolution du vivant, de l’organe à l’outil » (p. 116). L’auteur traite ensuite de l’alternative entre « destin ou liberté » (p. 118-132), dont on comprend à quel point elle découle de ce pas de côté par rapport au rapport heideggérien à la modernité occidentale. « Face au destin de l’Être, il est urgent de ne rien faire, car tout activisme de type éthique ou politique ne ferait qu’empirer le mal » (p. 120), telle est la synthèse que propose Fabre de la position du maître, soit « l’expression d’un principe d’irresponsabilité » (ibid.). Jonas, en disciple dissident, cherche à lier technique et liberté (p. 127-131) et soutient que la responsabilité de l’homme est de fixer – par une « vigilance éthique » (p. 132) – des limites aux propres déploiements de sa liberté et de sa technique.
Le chapitre VII, « De l’éthique à la politique » (p. 133-148), peut donc se lire comme une tentative de mise à l’épreuve des propositions de Jonas dans l’espace public et l’agir en commun, et non plus au niveau de la conscience morale individuelle. Le scepticisme de Jonas quant aux capacités de la démocratie à « promouvoir une modération du mode de vie et une maîtrise du processus technique » (p. 133) l’engage à envisager – avec réticence – le recours provisoire à une tyrannie bienveillante. Pour pondérer ce versant illibéral potentiel de la pensée jonassienne, Fabre recourt respectivement (et prudemment, car les compatibilités théoriques ne vont pas de soi) aux éthiques de la discussion d’Apel et Habermas et à la politique entre égaux d’Arendt. La critique de la conception parentale – donc potentiellement paternaliste – de la responsabilité chez Jonas est ici au cœur du propos.
Le couple « Responsabilité et précaution » (p. 149-174) est ensuite au cœur du huitième chapitre. Il est difficile, dans l’espace de texte ici mobilisable, de rendre justice à la finesse d’une articulation qui mêle critique de la critique hâtive de Jonas comme un deep-ecologist qu’il n’est pas et lecture de ses exégètes et de celles et ceux qu’il a pu inspirer comme Larrère ou Dupuy. L’esprit nous en semble synthétisé au mieux par l’éclairante comparaison mobilisée entre l’auteur allemand contemporain et son homonyme biblique. Le prophète Jonas, qui souhaite pourtant la destruction de Ninive, est envoyé contre son gré par Yahvé y faire une annonce de ruine prochaine, qui conduit finalement les habitants à la conversion et au salut. Il est donc à la fois un prophète démenti et un vecteur du salut des Assyriens ennemis d’Israël. Le philosophe du principe de responsabilité, lui, « prophétise la catastrophe pour qu’elle n’arrive pas » (p. 180), et « son souhait le plus cher est que la prophétie de malheur ne se réalise pas » (p. 170). Fabre conclut (p. 175-181) la deuxième partie de son ouvrage en proposant un essai de situation claire – notamment par le biais d’utiles tableaux de synthèse – de « Jonas dans le contexte de la pensée post-heideggérienne, ainsi que dans celui de l’écologie contemporaine » (p. 175).
La troisième partie, elle, montre la manière dont le recours à Jonas peut être mobilisé « pour une éducation à la responsabilité » (p. 183-279) capable de prendre de front les enjeux de notre avenir incertain, sans éluder ce que l’analyse et l’action ont ici de complexe. Le neuvième chapitre mobilise, pour penser l’éducation dans un monde incertain, deux ressources de sens : « science-fiction et prophétie » (p. 184-200). Grand connaisseur de Jules Verne – et connaissant notamment son rapport plus ambivalent qu’on le pense parfois à la modernité technologique -, Fabre recourt à une lecture du roman Sens dessus dessous et au concept jonassien d’heuristique de la peur pour donner à voir les travers potentiels de l’hybris prométhéenne et de la course au profit en matière de géo-ingénierie.
Le chapitre X est dédié à travailler une alternative complexe : « Bio-pouvoir ou Bio-légitimité » (p. 201-224), le premier terme étant un héritage de Foucault et ayant conduit nombre de celles et ceux qu’il a inspirés à penser les enjeux de gestion publique des conditions de vie au prisme de l’antagonisme supposé entre liberté et sécurité. Travaillant à partir de la distinction arendtienne entre zoé (vie biologique) et bios (vie politique, sociale, morale), l’auteur montre que Jonas nous aide à adopter une perspective plus dialectique. En un sens, il s’agit de tirer avec Jonas les conséquences de ce que Fabre présente comme la « meilleure critique de l’idéalisme de la phénoménologie, [à savoir] l’insolente formule de Berthold Brecht « D’abord la bouffe ensuite la morale » » (p. 218). Ainsi peut être défini un concept de bio-légitimité, selon un terme emprunté à Didier Fassin : l’idée que « la vie doit être protégée quoi qu’il en coûte » (p. 214). Seulement, en la matière, connaître la menace ne suffit pas à mobiliser les personnes contre elle, notamment s’agissant des enjeux environnementaux.
« Qu’as-tu fait papa, toi qui savais ? » (p. 225-241), telle est la pesante question en compagnie de laquelle l’auteur nous invite à cheminer dans son onzième chapitre. L’analyse de la posture de la jeune activiste climatique suédoise Greta Thunberg est ici au cœur du propos. À égale distance de la célébration charismatique et du dédain envers ce personnage des temps hypermodernes, Fabre insiste sur le fait que c’est ici la « procrastination des adultes qui provoque la précocité chez les jeunes » (p. 238). Greta Thunberg est doublement jonassienne, au sens où elle annonce la catastrophe pour espérer l’éviter, mais aussi au sens où elle se fait capitaine du fameux argument du même nom mobilisé par Jonas et exposé ci-avant. Ainsi, sa puissance de mobilisation et d’interpellation se paie d’un retour (bien qu’inversé) du paternalisme jonassien, là où pour l’auteur l’enjeu est plutôt de « nous mettre tous au travail, fraternellement, pour assumer ensemble nos responsabilités devant l’avenir » (p. 241).
Prolongeant la logique de réinvestir de fortes formules issues des mobilisations des jeunes pour le climat, l’auteur intitule son chapitre XII « Nous ferons nos devoirs quand vous ferez les vôtres » (p. 242-256). Dialoguant avec la conception durkheimienne du devoir et de la conversion, Fabre montre que Jonas nous aide à tenir ensemble devant les générations futures les exigences de non-dilapidation de trois héritages complémentaires qui font l’humanité de l’humain : héritage génétique, ressources naturelles soutenant la vie, héritage culturel et conditions de possibilité de l’existence éthique. Penseur de longue date de la formation, l’auteur insiste sur le fait qu’une école qui enseigne des savoirs mais ne forme pas ou plus – au sens d’engager une « transformation du sujet vers plus de réflexivité, de cohérence interne, d’ouverture » (p. 253) – ne peut permettre de faire face aux enjeux de l’anthropocène.
Le treizième et dernier chapitre de l’ouvrage – « Éduquer à la responsabilité » (p. 257-276) – réfléchit aux manières potentielles de parer à ce risque. Un point essentiel – qui recoupe un apport épistémologique et théorique fort proposé par Fabre ici dans un domaine peu connu par le lectorat francophone – est de prendre conscience qu’il s’agit ici de faire face à des « problèmes pernicieux » (p. 265-269), ou Wicked problems. Ces derniers : 1° n’ont pas de solution véritable ; 2° ne connaissent pas de terme dans leur construction même ; 3° sont à ce point pris dans des nœuds complexes que toute action provoque des réactions en chaine impossibles à anticiper totalement ; 4° ne peuvent supporter leur abord par essais-erreurs, les conséquences de chaque action étant trop importantes. Après les membres verniens du Gun-Club, c’est ici le fouisseur kafkaïen du Terrier – tourmenté par l’impossibilité de construire l’habitat souterrain parfaitement sécure – qui est convoqué à titre d’illustration littéraire et exemplaire. Ainsi, on ne peut attendre de l’école qu’elle règle seule de tels problèmes, mais on peut espérer (exiger ?) qu’elle place au cours de leur cursus les élèves dans des « situations où soit simulée la prise en compte de problèmes pernicieux » (p. 275). La conclusion de cette dernière partie (p. 277-279) permet à Fabre d’insister sur la nécessité d’outiller la responsabilité (p. 278) des générations à venir par une appréhension de l’éducation et de la formation intégrant la bio-légitimité sans se faire pour autant bio-pouvoir.
La conclusion générale de l’ouvrage (p. 281-301) permet à Fabre de synthétiser les réponses proposées par Jonas à ce que sont pour Kant les quatre grandes questions philosophiques : « Que puis-je savoir ? » (métaphysique) ; « Que dois-je faire ? » (morale) ; « Que puis-je espérer ? » (religion) ; « Qu’est-ce que l’homme ? » (anthropologie). Comme on le sait, pour le philosophe de Königsberg, les trois premières questions culminent dans la quatrième, et ici Jonas répond : l’homme est cet être à la fois naturel et responsable moralement, ayant à la fois une condition et une liberté, une part d’invariance et une part d’évolution. C’est en équilibre sur cette ligne de crête que l’humain peut et doit se confronter aux problèmes de son temps. Une phrase de l’ouverture conclusive trouve à ce titre à notre oreille une résonance particulière : « l’espoir et le désespoir font partie du problème et renvoient à notre responsabilité » (p. 301).
S’il fallait trouver une formule brève pour décrire le ton de ce livre, il nous semble que l’érudition hospitalière serait bonne candidate. La lecture de l’œuvre complexe de Jonas est en effet aussi serrée que sa restitution soucieuse d’être limpide, l’ensemble des analyses sont très référencées et renvoient à une bibliographie fournie, sans jamais renier pour autant le souci pédagogique d’ouvrir ces analyses à un large lectorat interpellé par les thèmes saisis. De même, l’auteur jamais ne cède aux deux tentations qui semblent le lot des exégètes pressés de Jonas, celles d’en faire un prophète ou un mauvais génie, un phare dans la nuit ou un oiseau de mauvais augure. « Penser avec et quelques fois contre Jonas est une aventure, qui, loin de se clore sur des réponses définitives, ouvre de nouveaux questionnements » annonce d’ailleurs la quatrième de couverture de l’ouvrage, et à ce titre, la rencontre du penseur allemand et d’un spécialiste de la philosophie du problème a donc tout de l’heureuse et féconde conjonction. Un troisième tour de force de l’ouvrage est à notre sens de réussir à marier des remontées assez vertigineuses aux sources présocratiques de la philosophie occidentale ou aux querelles théologiques des premiers siècles du christianisme avec une prise directe sur les évènements les plus contemporains comme les mobilisations des jeunes pour le climat ou la pandémie de coronavirus, sans jamais produire un sentiment d’anachronisme ou d’égarement du lectorat.
Pour toutes ces raisons, arrivés au terme de cette recension, ce n’est pas – comme souvent – un regret que nous souhaiterions exprimer, mais plutôt un triple souhait dont la réalisation – espérons-le pour rester à notre tour dans l’esprit de Jonas plutôt que dans celui de Bloch – ne tient (peut-être) pas uniquement de l’utopie. Le premier souhait est que ce livre trouve une bonne place dans la bibliothèque de toutes celles et de tous ceux, de plus en plus nombreux, qui fond des enjeux de l’anthropocène et de l’avenir incertain, des objets et des ressorts du travail scientifique sur l’éducation et la formation. Le deuxième souhait est que le souci d’équilibre et de refus de tout dogmatisme dans l’abord minutieux des sources et des positions en présence qui jalonnent tout ce livre infuse davantage dans le champ – lui aussi fertile – des interventions dans l’espace public sur ces sujets. Le troisième est de rappeler – en des temps où cela ne semble pas toujours être une évidence largement partagée – l’importance de maintenir vive la voix de la philosophie de l’éducation dans l’espace multi référentiel et interdisciplinaire des sciences de l’éducation et de la formation. Jugée à l’aune de ce type de contribution, celle-ci ne saurait – à notre sens – faire de doute.
Évaluations, sources de synergies ?
Auteurs : sous la direction de Nathalie Younès, Christophe Gremion et Emmanuel Sylvestre, Édition des Presses de l’ADMEE, ADMEE Europe, Neuchâtel (2020).
Par Alban Roblez, Université Sorbonne Paris Nord, France
 Pour ce premier ouvrage des Presses de l’Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation (ADMEE) en Education Europe[1] et Canada[2] dirigé par Younès, Gremion et Sylvestre, la richesse des thèmes abordés et des expériences de recherche constitue un vrai moment heuristique pour les praticien·nes, chercheur·es et curieuses ou curieux de l’évaluation en éducation. Que dire des évaluations comme « sources des synergies » ? La question donne le ton d’ensemble de cet ouvrage collectif de lendemain de colloque de l’ADMEE Europe (Lausanne, 2019) et ses auteur·es se proposent d’aborder l’évaluation toujours en reliance (Maubant, chapitre 8) avec ses réalités contextuelles, anthropologiques, pratiques et idéologiques ; bref comme une pratique complexe de professionnalité(s) qui dialogue et fait dialoguer ses sujets…jusqu’à tendre vers « une évaluation dialogique », comme le proposent Figari et Gremion comme mise en perspective de fin d’ouvrage (p. 263). C’est-à-dire que les cadres de discussions sont ici dépassés, de façon à rendre compte de toute la complexité de ce que peut être l’évaluation dès lors que nous nous intéressons à une « Action coordonnée de plusieurs systèmes, organes, éléments anatomiques ou biologiques d’où résulte l’accomplissement d’une fonction, l’exécution d’un mouvement. » si l’on suit la définition que propose le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, 2021) de la synergie. A ceci près que nous remplaçons bien volontiers les qualificatifs « anatomiques ou biologiques » par dialogiques, de par l’essence de communication de l’évaluation (Weiss, 1992 ; Figari et Remaud, 2014), et par méthodologiques, de par les enjeux praxéologiques (Marcel, 2010) de cet objet des sciences de l’éducation et de la formation. Bref, ce livre est à lire dès lors qu’on s’intéresse à ce que peut être « plus » que de l’évaluation telle qu’on se la représente, sans rejeter pour autant les avertissements des tendances néo-libérales qui traversent et malmènent notre milieu (Hadji, 2021) et dont l’émancipation peut générer dialogue à son tour (Marcel et Broussal, sous presses).
Pour ce premier ouvrage des Presses de l’Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation (ADMEE) en Education Europe[1] et Canada[2] dirigé par Younès, Gremion et Sylvestre, la richesse des thèmes abordés et des expériences de recherche constitue un vrai moment heuristique pour les praticien·nes, chercheur·es et curieuses ou curieux de l’évaluation en éducation. Que dire des évaluations comme « sources des synergies » ? La question donne le ton d’ensemble de cet ouvrage collectif de lendemain de colloque de l’ADMEE Europe (Lausanne, 2019) et ses auteur·es se proposent d’aborder l’évaluation toujours en reliance (Maubant, chapitre 8) avec ses réalités contextuelles, anthropologiques, pratiques et idéologiques ; bref comme une pratique complexe de professionnalité(s) qui dialogue et fait dialoguer ses sujets…jusqu’à tendre vers « une évaluation dialogique », comme le proposent Figari et Gremion comme mise en perspective de fin d’ouvrage (p. 263). C’est-à-dire que les cadres de discussions sont ici dépassés, de façon à rendre compte de toute la complexité de ce que peut être l’évaluation dès lors que nous nous intéressons à une « Action coordonnée de plusieurs systèmes, organes, éléments anatomiques ou biologiques d’où résulte l’accomplissement d’une fonction, l’exécution d’un mouvement. » si l’on suit la définition que propose le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, 2021) de la synergie. A ceci près que nous remplaçons bien volontiers les qualificatifs « anatomiques ou biologiques » par dialogiques, de par l’essence de communication de l’évaluation (Weiss, 1992 ; Figari et Remaud, 2014), et par méthodologiques, de par les enjeux praxéologiques (Marcel, 2010) de cet objet des sciences de l’éducation et de la formation. Bref, ce livre est à lire dès lors qu’on s’intéresse à ce que peut être « plus » que de l’évaluation telle qu’on se la représente, sans rejeter pour autant les avertissements des tendances néo-libérales qui traversent et malmènent notre milieu (Hadji, 2021) et dont l’émancipation peut générer dialogue à son tour (Marcel et Broussal, sous presses).
Le premier chapitre donne à lire le dialogue autour de ce qui fait norme dans les évaluations. Les normes peuvent être instruites pour piloter les systèmes éducatifs dans une qualité équitable quant aux procédures (p. 35). Elles peuvent être des balises pour repérer ces zones alternatives, autres, voire hors-normes définies envers elles et nous intéresser sur nos fonctions enseignantes et d’apprentissage : nous interpeller quant à l’éthique de notre place et de nos fonctions (p. 41), jusqu’au rappel biographique que la norme est ce qu’on en fait – comme résultat – et ce qu’on en vit – comme marque de soi – grâce au témoignage d’un des dialoguants (p. 49). Dialectiquement, ces enjeux amènent à observer le rôle heuristique du contexte hébergeant la pratique évaluative venant nécessairement l’impacter (p. 42). Le ton est donné : les normes peuvent s’observer comme se (co)construire, il en va de relations entre un panel de composantes et de vécus, d’ « invariants » (Mottier-Lopez, 2017) et d’émergence. Les choses bougent.
Et bousculent. Le chapitre 2 poursuit un dialogue de 2011 (Butera et al., 2011) en répertoriant différentes « menaces » de la note, figure prototypique « de l’évaluation normative et de la sélection que cette forme d’évaluation sert. » (p. 56). Ce chapitre ravive l’occasion de penser la synergie par son envers, l’antagonisme que sert une idéologie portée par la comparaison sociale et la sélection de sujets dans un système classant. Ainsi « l’idée d’évaluation » (Demailly, 2012) rappelle au pacte social éprouvé dans les systèmes de l’éducation et de la formation : la seule présence de la note obstruerait ce pan de l’éducation, passant d’une synergie formative (p. 62) et coopérative (p. 63) à une inertie face à l’obstacle menaçant que représentent les effets psycho-sociaux de la note.
Les dialogues ne sont, par conséquent, pas sans tensions. Quelles soient de nature conceptuelles, réinterrogeant les fonctions conceptuelles certificatives et formatives de l’évaluation, dans le chapitre 3, en contexte de recherches collaboratives, ou en mise en significations dans les contextes didactiques, dans le chapitre 4 : les synergies s’éprouvent dans la richesse dialogale des postures adoptées, retravaillées sans cesse, par les différentes parties-prenantes à la recherche. Ainsi peut-on parler d’ « écologie » (Giglio et Mottier-Lopez, chapitre 3 ; Schwartz, chapitre 6 ; Younès, 2020) dans le sens de se laisser aussi surprendre à resignifier et faire signifier ce qui fonde les cultures de l’évaluation avec des nœuds de tensions que les auteures soulignent dans les contextes d’apprentissage (p. 83). Les cultures ou épistémologies de l’éducation comme la didactique continuent de faire l’objet de recension et d’ouverture évaluatrice de la valeur-même des évaluations, à partir par exemple du concept de « validité didactique » comme le propose Vantourout (p. 117). Ces deux chapitres poursuivent les perspectives heuristiques quant aux dialogues inter-épistémologies et inter-pratiques entre communautés de praticien·nes et de chercheur·es de l’éducation et de la formation dont les évaluations peuvent situer l’acmé de débats de valeurs et de sens, de scientificité et d’agirs.
Les chapitres 5 et 6 viennent comme repositionner le débat quant à ce qu’il reste des évaluations, comme un moment intermédiaire épistémique, fort de la lecture des chapitres précédents. Avec Mottier-Lopez (chapitre 5) on comprend que la normalisation n’a de sens que par ses processus de « RE » (Vial, 2009) : renormalisation, régulation, référentialisation (Figari, 1994) (p. 130). A partir d’un essai de conceptualisation de ce que peut être la normalisation, entre « normativité » et « normalité » (pp. 132-138), l’auteure nous invite à observer du côté du sujet-évaluatrice dans une dynamique herméneutique entre comprendre les singularités vécues et incarnantes des conduites des évaluations et les explications toujours potentielles de phénomènes évaluatifs référencés, mis en tension quant au réel, donnant la part belle aux consensus qui s’élaborent en situation (p. 149). Avec Schwartz (chapitre six) nous comprenons le pendant sur l’objet-même qu’est l’évaluation qui se constitue intrinsèquement sur deux « pôles » tous deux nécessaires et vitaux quant à ce qui caractérise l’agir évaluatif. Cette entrée par les pôles (pp. 160-165) pose sans figer toute la dimension axiologique qui caractérise l’agir humain, comme l’agir évaluatif-même, construction continue de valeurs (Lecointe, 1997). La proposition dépasse la dichotomie des « logiques » de Vial (2009) où, rejoignant celui-ci quant au pouvoir d’agir du sujet « évaluant »[3], un troisième pôle dialogal s’institue dans et par l’agir : « celui d’un “monde commun à construire“ » (p. 173).
Les chapitres 7 et 8 viennent illustrer les états de discussions de ces constructions se faisant et se visant. Les auteur·es du chapitre sept viennent rendre compte, à l’issue d’un symposium sur la recherche en validation des acquis de l’expérience (RVAE) à la fois des évolutions des formes modales et des enjeux évaluatifs qui s’y observent et viennent redessiner à leur tour les pratiques (p. 190). Maubant au chapitre 8 déplace le dialogue sur les formations en alternance dans les milieux professionnels et universitaires dans différents pays. A partir de recensions (pp. 202-206), c’est un visage connu mais pourtant encore tiraillé par ses inscriptions épistémologiques et fantasmées qui incarnerait cette attitude synergétique dont les contextes d’alternance soutiennent à rendre visible : l’accompagnement évaluatif. Entre visées de développement professionnel et présence dans l’absence (p. 223). Par la pratique comme par la posture, ces tiers-figures dégagent des possibles du fait d’une mise en conversation, entre savoirs et agirs.
Cette tension finalement se retrouve illustrée et incarnée par l’enseignant·e-chercheur·e en France. Younès (chapitre 9) donne à lire l’histoire de cette figure socio-professionnelle (pp. 235-239) où enseignement et recherche s’entrecroisent, s’entrechoquent ou se nourrissent dans la professionnalité des personnes enquêtées. Les évaluations, celles conduites comme celles vécus par ce sujet singulier, peuvent situer dans le processualité le « mouvement » (p. 246) de dépassement des difficultés (réelles et éprouvées) pour une forme autosynergétique du fait de l’investissement dans une profession qui a du sens et qui s’inscrit dans une histoire politique et axiologique toujours en écriture, dont le sujet peut prendre partie dans ses contextes d’interventions.
Pour conclure Figari et Gremion relisent les chapitres et invitent à ne pas se braquer à une volonté de résoudre les tensions, mais bien à les faire dialoguer et à s’y prêter : « L’évaluation étant toujours, d’abord, une situation et une pratique, on ne cherchera pas à dérouler, ici, une typologie de tensions entre idées, conceptions ou théories. » (p. 252) mais du fait d’une posture à adopter, à la recherche d’une « vérité évaluative » (p. 255) au carrefour des tensions émergentes : entre normalisation et développement (pp. 253-254), entre externalité et internalité (p. 254) et entre objectivité et subjectivité (pp. 254-255). Les auteurs décrivent les différentes facettes que pourrait figurer cette posture incarnée (pp. 255-263) toutes visant à une dialogisation de l’évaluation, c’est-à-dire du dépassement de la synthèse des rapprochements pour aller vers la cocréation du tiers présent et se découvrant à mesure des échanges. Ainsi peut-on revenir aux propos introductifs de Younès, Gremion et Sylvestre et à leur hypothèse : dans « tout processus d’évaluation », au-delà des coexistences des « différentes finalités et pratiques » évaluatives, « leurs légitimités, articulations, compatibilités et valeurs respectives » sont en synergies (pp. 15-16). Cet ouvrage donne les moyens de voir les différentes voies possibles pour leur donner voix.
[3] Pour rappel avec Vial (2012) que l’on voit comme autant l’évaluatrice que l’évaluée (Ibid., p. 421).
S’engager dans la recherche en sciences humaines et sociales
Auteurs : Augustin Mutuale et Guy Berger. Éditeur : ESF, Paris (2020), Le champ de l’éducation (Pédagogies), sciences humaines.
Par Jean Clénet, Université de Lille, France
Nous commençons par remercier Guy Berger et Augustin Mutuale pour l’écriture de cet ouvrage original, accessible et profond. Qualités premières quand il s’agit de penser l’accompagnement intellectuel de la recherche en sciences humaines et sociales dans le champ de l’éducation. Pour l’essentiel, sa lecture nous a convaincu des puissances conceptuelles mises au service d’implications et/ou d’engagements humains dans la recherche. Nous pensons aux apprentis-chercheurs pouvant trouver dans cet ouvrage les clés pour produire leurs propres recherches en vue de l’obtention du titre de docteur. Des clés et des outils intellectuels pertinents y sont proposés pour en penser trois dimensions itératives et récursives : la conception, la construction et la conduite. Des directeurs de recherche peuvent également en faire un miroir pour réfléchir des effets de leurs pratiques de direction et/ou de leurs pratiques accompagnement. Au-delà, il intéressera toute personne concernée par des pratiques d’éducation et de formation et par d’autres activités finalisées par des problèmes humains. Cet ouvrage hautement pédagogique fournit des outils d’intelligibilité du processus de recherche en éducation. Il permet de le penser, et de le mettre en œuvre, autrement que par les seules méthodes et/ou par les didactiques. Il permet surtout d’en comprendre les jeux et les enjeux. À tous ces égards, c’est un ouvrage heuristiquement fort. Probablement cette force réside-t-elle d’une part, dans des enracinements philosophiques qui traversent les grandes questions qu’il conviendrait d’associer à tout processus de recherche, complexe, où l’humain est fondamentalement premier.
Qu’est-ce que s’engager en recherche ? Quelles postures, méthodes et ressources intellectuelles adopter ? Qu’est-ce que produire des savoirs scientifiques et quels en sont les enjeux et jeux humains, sociaux, politiques ? Questions que les temps de la néo-modernité tendent parfois à réduire à de simples techniques ou à des méthodes appliquées. À l’inverse, cet ouvrage soutient un certain art d’accompagner autrui dans la production de nouveaux savoirs à partir de connaissances incomplètes. Il entraîne le lecteur bien au-delà des manuels de méthodologie qui dictent parfois plus qu’ils n’incitent à la réflexion. Il aide à se penser soi-même entre implication et engagement. Il conduit à penser l’objet de recherche comme un sujet, comme un objet et comme un projet complexifié. Il éveille l’attention et suscite des reliances. Il suggère des constructions en laissant le choix à autrui de produire son propre cheminement.
L’ouvrage est décliné en huit chapitres dont les titres et les enchaînements font globalement sens : penser et écrire à deux ; les enjeux de la recherche en éducation ; pluralité des enjeux et des objets de la recherche en éducation ; préalables pour penser la recherche en éducation ; se questionner : implication et journal de recherche ; réfléchir et situer son questionnement et ses outils de recherche ; situer, relier articuler ; la recherche : processus social de subjectivation et d’émancipation. Ces huit chapitres relativement équilibrés par leur importance et par leur organisation se font écho et répondent à un titre mobilisateur : S’engager dans la recherche en sciences humaines et sociales, et à un sous-titre précisant le champ de l’éducation. Pour rédiger cette recension, notre choix est de nous inscrire autant que possible dans les conceptions soutenues par les auteurs, pour en agréger des connaissances qui résonnent et nous aident à raisonner. À notre mesure, il nous incite à poursuivre le chemin ouvert, sans ambition d’achever le parcours, comme nous le suggère Meirieu dans la postface de l’ouvrage. Nous suivrons donc le chemin tracé non sans quelques retours, détours et contours.
Dans le chapitre introductif, les auteurs se positionnent dans un « nous » rédacteur. Ils présentent la recherche comme une dynamique constructive à agir dans des espaces-temps sociaux. Cela pose, entre autres, la vaste question de l’implication versus l’engagement du chercheur. Quelques balises y sont posées pour engager une démarche de problématisation et formuler des hypothèses tout en étant attentif aux biais de l’action humaine. Être attentif par exemple, à des réalités perçues et/ou conçues d’avance, aux conflits d’intérêts intimes émergeant lors de l’entrée dans le processus de recherche et qui consiste à produire paradoxalement la connaissance de la connaissance (Morin, 1986). Les auteurs évoquent les croyances, les opinions et les autres informations. Mais nous savons aussi qu’il faut compter avec les intérêts et les illusions, les images et autres représentations, les écoles de pensées, les idéologies et/ou les doctrines. S’engager dans la recherche en sciences humaines pourrait bien être, aussi, un engagement en soi, à lutter contre soi, car comme l’écrivent les auteurs : « le risque est de s’aveugler et de s’enfermer dans le dogmatisme de la démonstrativité » (p. 21). Ou s’employer à tracer un chemin entre ces deux clairs-obscurs : entre-soi et autrui.
Le deuxième chapitre entend soulever les principaux enjeux de la recherche en éducation. Nous en retiendrons trois. Dans le prolongement du processus d’engagement, la question du système de pensée à mobiliser en référence est essentielle. Si le jeune chercheur s’inscrit dans la pensée d’une certaine école, l’ouverture à d’autres devient aussi nécessaire. Savoir d’où l’on tient ce que l’on sait conduit à un élargissement de la pensée. Cela suggère un second enjeu. La complexification des regards et l’élargissement de la pensée contribuent à renforcer les motifs d’intérêts pour la recherche. Créer des illusions fécondes, en imaginer d’autres, considérer le savoir des êtres humains, redonner à la recherche des pouvoirs d’agir auprès et avec d’autrui, tout cela conduit à légitimer la recherche en actualisant ses puissants potentiels trans-formateurs, dès lors qu’elle considère le savoir des acteurs sociaux et s’engage à les associer à la production des savoirs. En affirmant cela, l’ethnométhodologie prend tout son sens. Cela nous conduit à interroger des postures parfois convenues, comme celle de la toute-puissance de la recherche dont les chercheurs useraient et abuseraient. Le troisième enjeu est celui de la variété épistémique et de leurs valeurs. L’éducation est un champ où sont présentes nombre de disciplines. Mais l’humain n’est pas un bien ni un service pouvant être réduit aisément. Il n’appartient à personne. Il n’est pas réductible à de seuls et exclusifs regards disciplinaires. Les champs de l’éducation et de la formation sont riches de cette complexité faite de sujets, de projets, d’activités, d’espaces, de temps, de finalités, de situations singulières mais fondamentalement humaines.
Le troisième chapitre complexifie cette grande question de la recherche en éducation en convoquant plusieurs courants de recherche historiquement travaillés au sein de l’AFIRSE[1] et de l’AECSE[2]. Ces courants ont été portés par des figures connues et reconnues : Gaston Mialaret, Jacques Ardoino, Guy Berger. Pour Jacques Ardoino, l’Éducation est nécessairement plurielle. Elle se fait dans et par la vie. Dès lors, la recherche doit s’employer à donner un statut à l’hétérogène, et, si elle osait, à la complexité. Autrement dit, elle doit s’adapter au vivant hétérogène et singulier pour mieux le comprendre. Dans cette perspective, l’approche traditionnelle mobilisée en recherche, notamment les processus hypothético-déductif ou les modèles axiomatico-inductif ne sont plus pertinents. Pour rendre intelligible le monde, il convient d’admettre le statut des entre-deux intuitifs et humains, très présents en recherche, mais pudiquement voilés car souvent non admis au nom d’une certaine scientificité. Il n’est pas de concepts sans intuitions même si « des intuitions sans concept sont aveugles » (Kant, 1781/2012).
Guy Berger et Augustin Mutuale nous proposent un nouvel univers spatio-temporel de la connaissance impliquée, celle-ci requérant une compréhension au prisme de la « complexité par excellence » (p. 57). En adoptant cette épistémologie, les champs de la recherche s’emparent des espaces-temps, de la vie. Ils s’ouvrent. Ils font variations. Variétés, hétérogénéités et singularités constituent dès lors des invariants de toute recherche qui se doit de s’ouvrir à des « génies » conceptuels et méthodologiques renouvelés. Les différentes manières de penser la recherche doivent conduire à dépasser les déterminismes. Elles doivent nous inviter à accepter les incertitudes (Dupuy, 2002), en convoquant des modélisations intelligentes et intelligibles, en rendant compte de situations particulières et d’expériences singulières. À titre d’exemple, en 1979, Ilya Prigogine, physicien, et Isabelle Stengers, philosophe, ont montré combien les sciences de la nature et celles de la culture pouvaient être étudiées en interactions, ce qui permettait de « nouvelles alliances ».
Le chapitre quatre intitulé « préalables pour penser la recherche en éducation » s’emploie à traiter de trois « dimensions qui touchent directement à l’humain » (p. 76) : l’autre « dans sa différence », l’autre « objet de pensée », l’autre, celui « qui me fait face ». Ces dimensions constituent des problématiques philosophiques contribuant à éclairer la manière d’appréhender, d’intervenir, de rechercher et d’enseigner dans le domaine « des métiers adressés à autrui ». Ces dimensions essentielles proposées par les deux auteurs ne seraient-elles que des préalables ? Autrement dit, des éléments constitutifs de toute recherche et qui s’apprendraient avant d’entrer en recherche pour être appliquées ensuite ? Certes, un doctorant débutant doit satisfaire, au préalable, à quelques critères institués. Mais l’essentiel de ses apprentissages de jeune chercheur se fait chemin faisant. D’autant qu’entre les chemins aventureux de la recherche et son produit final, demeurent toujours des zones d’ombre. Il n’y a pas de lumière sans ombres. Les intentions de la recherche, les plans élaborés en amont, les questions et les méthodes envisagées, les rapports avec l’équipe de direction, les collègues et autres partenaires de jeu, les situations et les temps prévus, sont rarement tenables. La vie du chercheur se confronte avec l’idéal de la recherche. Un paradoxe de plus mais qui est sans doute nécessaire pour parvenir à mener à son terme un projet de recherche. En effet, le chercheur novice doit apprendre à se situer, lui et son objet, dans des temps déplacés, rassemblés, rassembleurs, à la fois historiques, actuels et projectifs. Apprendre la recherche, et c’est le cas de tout apprentissage, procède d’engagements et d’interactions entre des sujets, des artefacts, des situations et des temporalités. Les dynamiques temporelles génèrent l’invention du convenable (Simon, 1969). Et le convenable n’est ni donné ni pré-conçu. Il se construit. Il se révèle dès lors que le chercheur prend conscience de son rôle et des savoirs utiles à l’invention des conditions permettant à autrui de se construire en relative autonomie. Cette perspective rend nécessaire le développement de situations propices aux échanges et aux partages, en particulier les partages des pouvoirs du dire, du faire, du penser et du concevoir.
Le cinquième chapitre traite de l’implication du chercheur. Le débat suggéré ici concerne l’auto-production et la co-production du chercheur de son projet-sujet-objet de recherche. Ce chapitre vise à comprendre comment le chercheur apprend à concevoir et à agir dans et par sa recherche. Ce qui se joue ici est fort complexe. La question centrale est celle des « faire » de la recherche qui conduisent à la production de nouvelles connaissances. André de Peretti (2009) n’avait de cesse de rappeler que la connaissance, c’est co-naître ou naître avec. Penser et connaître sont ici reliés dans un même objet. Toute co-naissance requiert des intuitions sensibles sur soi et sur autrui. Toute connaissance est reliance. Toute connaissance s’appuie sur des formes d’entendements réfléchis, distanciés, c’est-à-dire sur des savoirs et des concepts dont la légitimité procède de leurs pertinences à l’épreuve des expériences humaines. Le mouvement réflexif entre l’acte de penser et l’acte de connaître est contingent à tout processus de recherche.
Le chapitre six propose d’aider à penser et situer le questionnement de la recherche. Il propose aussi de s’interroger sur les outils de la recherche, en attirant l’attention du lecteur. Il n’y a pas de méthode unique pour étudier les choses (Aristote, édition 2005). Les auteurs analysent les statuts, les fonctions et les sens de la question de recherche. De ce point de départ, ils nous invitent à nous interroger sur le processus de problématisation, sur la démarche visant à élaborer un univers théorique, à construire des hypothèses, des méthodes, des techniques et des outils. Le principe retenu par Berger et Mutuale est de mettre à l’épreuve « les exigences de la pensée » (p. 118). Cette intention est d’autant plus « exigeante » qu’elle concerne le sujet humain, être éminemment complexe, imprévisible, irréductible et souvent hors de contrôle du chercheur. Dès lors, comme il n’existe aucune théorie, aucun modèle, aucune méthode, aucune épistémologie unique, nous ne pouvons prétendre à d’autres façons que d’étudier, d’observer, d’écouter et in fine d’explorer ce sujet humain et vivant tel un complexe réel (Bachelard, 1938/2007). Le regard, la posture et le mode d’intervention du chercheur ne doivent pas négliger les situations (Quéré, 1997). Le chercheur se doit de les reconnaître afin d’inventer les conditions de l’émergence des connaissances scientifiques. Dans ces espaces élargis, le chercheur peut travailler à situer sa recherche, historiquement, politiquement, institutionnellement. Concernant plus précisément les recherches en sciences de l’éducation, les deux auteurs rappellent que son institutionnalisation a été chaotique. Les sciences de l’éducation, comme discipline scientifique, suscitent toujours aujourd’hui des réserves. Elles peinent à être reconnues socialement. L’une des raisons tient sans doute au fait que cette discipline récente a trop voulu imiter l’organisation disciplinaire traditionnelle en silos, alors qu’elle prétend étudier un monde complexe. Sans doute s’est-elle parfois égarée dans la primauté accordée aux outils, aux instruments au détriment de la prise en compte de la demande sociale fluctuante et de l’évolution des problématiques humaines. Et là, précisément, nous prenons la mesure que les outils ne sont qu’outils. L’essentiel des recherches en sciences humaines et sociales réside dans les situations réelles et les chemins que chaque pas du chercheur contribue à re-dessiner, en s’y engageant, ou pas, stratégiquement, scientifiquement, socialement et politiquement. Commentainsi apprendre à créer, à re-connaître des espaces ouverts de la recherche, par des explorations et pour des interactions originales, des étonnements, des moments sociaux inédits à capter, des émergences d’intuitions et des épistémologies à réinventer ? Dit autrement, comment redonner force et vie à la recherche en éducation ?
Le septième chapitre intitulé « situer, relier, articuler » suggère une offre paradigmatique déclinée en termes de totalités, d’interactions, de phénomènes, d’organisations et de systèmes (Von Bertalanffy, 1968/1993). De l’analytique à la systémique, de la situation aux temporalités, du débat entre théorie et pratique, des bouleversements épistémologiques, des limites quant à la saisie du global, tels sont les grandes idées développées dans ce chapitre. Les interrogations proposées sont fort bien pensées et sont solidement étayées pour convaincre. Elles s’offrent à des perspectives pouvant infléchir qualitativement la recherche en éducation. Il s’agit d’un profond changement de paradigme mettant en question l’implication et les cadres de références du chercheur. Désormais, les recherches en éducation invitent à un élargissement de la pensée. Nous nous situons ici sur les traces d’André de Peretti et de Georges Lerbet qui ont, tous deux, proposé des modélisations renouvelées de la recherche en éducation, convoquant souvent la théorie de la complexité qui, en changeant la vision de la réalité et la réalité de la vision, modifie la figure et le sens de l’action.
Le chapitre huit est construit comme une grande conclusion de la recherche visant à rassembler les grands enjeux des recherches en éducation et à questionner leur sens et leur fonction sociale. En convoquant Henry James qui considère que l’expérience n’est « jamais limitée, qu’elle est une immense sensibilité et une véritable atmosphère de l’esprit » (p. 169), les auteurs affirment une conception humanisée de la recherche humanisée. Cette définition de la recherche assigne à la connaissance un vrai statut actif et réflexif, constructif et productif, porteur de singulières significations selon le principe dialogique entre objectivation et subjectivation désignant non pas des entités mais des activités (Barbier, 2011). Voilà un pas décisif engagé vers des conceptions renouvelées de la recherche en éducation. Varela (1996) ne disait pas autre chose lorsqu’il travaillait à donner aux sciences cognitives un autre statut épistémologique, remettant en cause l’idée que la connaissance procède du traitement de l’information. Nous adhérons à l’idée des auteurs convoquant Dewey pour qui il est essentiel de construire des reliances entre un processus agi (l’expérience) et réfléchi (l’enquête). À cette condition première, l’expérience sensible trouve sa force et devient puissance (Ferry, 1991). Il s’agit de puissances apprenantes et de puissances trans-formatrices. C’est l’occasion de rappeler que les praticiens et les chercheurs se rejoignent dans le projet d’apprendre à « mieux penser » grâce à des échanges de connaissances et à des partages de pouvoir. C’est à partir de ces principes de complémentarité entre les formes de savoirs et des pratiques sociales associées, tournée vers des buts différenciés mais travaillés en commun, qu’est née la recherche-action. Réflexions dans l’action, en cours, après et sur l’action, dont les visées sont à la fois formatrices et trans-formatrices, à finalités sociales et professionnelles. L’ouvrage se termine par cette conception d’une recherche émancipatrice, socialement généreuse et indissociable d’un grand projet éducatif.
Comment souligner davantage la puissance de cet ouvrage ? En rappelant sans doute que l’on ne s’engage pas en recherche en sciences humaines par hasard. Ce qui fait sens et fins de l’action humaine, tant pour soi que pour autrui, se loge dans des « entre-deux » complexes, multiples, mêlant « plaisir de la découverte et quête d’originalité », « évitement de l’angoisse et quête d’une authentique valeur scientifique », « désirs d’advenir et besoin de reconnaissance ». Penser sa propre implication et au-delà, son engagement, c’est accepter in fine un désengagement relatif. Un directeur de recherche accompagne le chercheur novice dans ses apprentissages. Il autorise l’actualisation des potentiels d’autrui. Cette démarche n’est pas simple dans des environnements où les espaces et les enjeux de pouvoirs sont prégnants. prégnants. Ainsi, lorsqu’implication et engagement sont distingués mais reliés en unités réfléchies, ils deviennent l’un et l’autre, pour ne pas dire l’un dans l’autre une uni-dualité (Morin, 1986), sans que leur singularité se perde dans leur unité. Cela appelle à l’auto-et co-réflexion, au dialogue, à la compréhension et à la discussion critique, mais aussi à la coopération et à la recherche de fins et de valeurs spécifiques. Différenciées, échangées, partagées, érigées en axiologies, les synergies entre implication et engagement propulsent vers des ambitions émancipatrices. Autant de dimensions de la recherche en sciences humaines, que cet ouvrage éclaire, invite à remettre à l’œuvre et replace dans une éthique de la discussion rationnelle (Popper, 1981).
Les grandes questions de la recherche en sciences humaines développées par Guy Berger et Augustin Mutuale sont actualisées et fondamentalement enracinées dans la philosophie, cette belle école d’éducation dont les auteurs sont issus. Ils invitent à inscrire dans le processus de recherche une éthique des interactions entre soi et autrui, une éthique qualitative des rationalités humaines et de leur scientificité. Tout cela est montré et questionné avec simplicité et force. À bien des égards, il incite à la réflexion et à un retour sur soi. En effet, tout enseignant ou intervenant en éducation et formation, tout chercheur comme tout politique, pourrait tirer de cet ouvrage un profit réflexif dans des contextes et des moments sensibles où, parfois, la facilité, souvent l’urgence, le besoin d’exister et d’être reconnu, conduisent à des excès et forcent l’élaboration d’une réponse, quoi qu’il en coûte, à des commandes portées par des commanditaires peu engagés dans une réflexion sur le sens de leurs attentes. Trop souvent, dans les recherches en sciences humaines aujourd’hui, la norme tend à remplacer la valeur. La quantité des données tend à masquer la qualité des résultats et la nécessaire prudence dans leurs interprétations. Les commandes élaborées par quelques-uns l’emportent sur les besoins des populations. Fort heureusement, cet ouvrage contribue à replacer les recherches en éducation dans une singularité renouvelée propre à des sciences humaines réinventées et, somme toute, ré-humanisées.
Jean Clénet, Professeur émérite des Universités, Université de Lille
Bibliographie :
Aristote (Édition de 2005). De l’âme. Paris : Folio, essais.
Bachelard, G. (1938/2007). La formation de l’esprit scientifique. Paris : Presses universitaires de France.
Barbier, J.-M. (2011). Vocabulaire d’analyse des activités : penser les conceptualisations ordinaires. Presses universitaires de France.
De Peretti, A. (2009). Apprendre par les erreurs, ou le courage de l’approche rogérienne. Dans Approche Centrée sur la Personne. Pratique et recherche, (2) 10, 29-44.
Dupuy, J.-P. (2002). Pour un catastrophisme éclairé. Paris : Seuil.
Ferry, J.-M. (1991). Les puissances de la connaissance. Tomes I et II. Paris : Éditions du Cerf.
Kant, E. (1781/2012). Critique de la Raison pure. Quadrige. Paris : Presses universitaires de France.
Morin, E. (1986). La connaissance de la connaissance. La méthode. Tome III. Paris : Seuil.
Popper, K. (1981). Tolérance et responsabilité intellectuelle. Conférence Université de Tübingen.
Quéré, L. (1997). La situation toujours négligée ? Réseaux, (15) 85, 163-192.
Simon, H. A. (1969). Les sciences de l’artificiel. Paris : Folio, essais.
Varela, F. J. (1996). Introduction aux sciences cognitives. Paris : Seuil.
Von Bertalanffy (1969/1993). Théorie générale des systèmes. Paris : Dunod
[1] AFIRSE : Association francophone internationale de recherche scientifique en éducation
[2] AECSE : Association des enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation
La réforme des études en santé entre universitarisation et professionnalisation : le cas des Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie
Ouvrage dirigé par Thérèse Perez-Roux. Éditeur : L’Harmattan, Paris (2019)
Par Christiane Montandon, Université CY Paris, France
 Cet ouvrage a le mérite de résulter d’une véritable collaboration interdisciplinaire entre des enseignants chercheurs et des praticiens de terrain, réunis pour une recherche de trois années (2015-2018) sur les bouleversements du cursus de formation des masso-kinésithétapeutes (MK), suite à la réforme de 2015 des études de Masso-Kinésithérapie (MK). Avec l’exigence d’une inscription universitaire, le processus de professionnalisation des étudiants MK vise à développer non seulement une posture réflexive sur leurs pratiques mais aussi une démarche de recherche pour mieux analyser « leur capacité d’adaptation aux systèmes d’activité dans le champ du travail » (p. 28). Or, en référence à une double appartenance institutionnelle, (instituts de formation MK/Université), cette réforme ne va pas sans interroger aussi les formateurs et leurs modalités d’intervention dans la manière d’articuler apports théoriques, stages pratiques et leur nécessaire inscription dans une réflexion critique sur les savoirs enracinés dans la pratique.
Cet ouvrage a le mérite de résulter d’une véritable collaboration interdisciplinaire entre des enseignants chercheurs et des praticiens de terrain, réunis pour une recherche de trois années (2015-2018) sur les bouleversements du cursus de formation des masso-kinésithétapeutes (MK), suite à la réforme de 2015 des études de Masso-Kinésithérapie (MK). Avec l’exigence d’une inscription universitaire, le processus de professionnalisation des étudiants MK vise à développer non seulement une posture réflexive sur leurs pratiques mais aussi une démarche de recherche pour mieux analyser « leur capacité d’adaptation aux systèmes d’activité dans le champ du travail » (p. 28). Or, en référence à une double appartenance institutionnelle, (instituts de formation MK/Université), cette réforme ne va pas sans interroger aussi les formateurs et leurs modalités d’intervention dans la manière d’articuler apports théoriques, stages pratiques et leur nécessaire inscription dans une réflexion critique sur les savoirs enracinés dans la pratique.
La structuration de l’ouvrage, en trois grandes parties, se consacre d’abord à présenter au niveau national dans une perspective socio-historique, l’impact de la réingénierie de la formation du point de vue de l’identité professionnelle tant chez les étudiants que chez les formateurs et les tensions qui en résultent. En effet, la refonte du curriculum, dans « une approche par les compétences, une organisation pédagogique fondée sur le socio-constructivisme » (p. 55), vise à faire du MK un décideur, responsable du diagnostic kinésithérapeutique, où les impératifs d’autonomisation et de responsabilisation lui donnent un pouvoir décisionnel, à partir du moment où a pu se développer une méthodologie de recherche dans le contexte universitaire. La réforme oblige chaque centre de formation à passer une convention avec une université disposant d’une composante santé, avec nécessité de valider une première année en faculté de médecine, ce qui porte à 5 années la durée de la formation. Pierre Hébrard procède à une comparaison entre les textes de 1989 régissant l’ancien cursus et ceux de la réforme de 2015, les uns centrés sur « les contenus de connaissances à acquérir », les seconds fondés « sur des référentiels d’activités et de compétences » (p. 57). Il souligne depuis 2005 la convergence des réformes précédentes dans les secteurs de la santé (aides soignants, auxilaires de puériculture, infirmiers) et du travail social, tout en portant un regard critique sur l’impression d’émiettement que donne « l’aspect prescriptif et pointilleux des référentiels de compétences » (p. 68), bien que voulant aussi développer autonomie et réflexivité des étudiants. L’ambiguïté d’une telle approche, ainsi que la place réservée aux sciences humaines et sociales révèlent l’enjeu de la nécessité d’un changement de culture pédagogique, ce qui conduira Thérèse Pérez-Roux et Éric. Maleyrot à privilégier au niveau local comme objet de recherche un dispositif innovant, susceptible de pouvoir concilier les dimensions théorique, technique et clinique de la formation. L’analyse de ce dispositif, GEAPR, fera l’objet de toute la troisième partie du livre, occasion d’analyser dans tous ses aspects pédagogiques, didactiques et organisationnelles, la dimension réflexive de la formation et les changements de posture que cela implique chez les formateurs.
Des considérations méthodologiques terminent cette première partie, en présentant, d’un côté, les résultats d’une enquête quantitative (2018) auprès de 694 étudiants MK, de l’autre les résultats d’une enquête par questionnaire (141 réponses de divers instituts) et d’entretiens (semi-directifs et par focus group) de 2015 à 2017 auprès des formateurs d’un IFMK. « Les étudiants ont remarqué une évolution des pratiques enseignantes » (p. 76). Mais malgré l’alternance plus intégrative des stages « la réflexivité pourtant au cœur de la réforme est quasi-absente de leurs réponses » (p. 100). Pour les formateurs la transition professionnelle décisive qu’exige cette réforme s’exprime par des besoins en formation, en particulier quant à la méthodologie de la recherche et de l’analyse des pratiques, ce qui implique un retour à l’université. Ce dépouillement des données, particulièrement documenté, fait apparaître une absence de collaboration entre IFMK et université, où les métiers de la rééducation restent méconnus, car ils ne font pas pour l’instant l’objet d’une filière universitaire spécifique.
La seconde partie se focalise désormais au niveau local sur les défis et les difficultés qu’affronte un institut de formation de masso-kinésithérapie (IFMK) pour réorganiser ses modules de formation. En 2015, le renouvellement de la direction offre une opportunité particulièrement favorable pour combiner la mise en œuvre de la réforme et recherche collaborative avec les chercheurs qui avaient accueilli et suivi le directeur et le directeur-adjoint de cet IFMK inscrits dans un Master en sciences de l’éducation. La constitution d’un tel réseau d’acteurs permet aux chercheurs de les accompagner pendant trois ans et d’analyser les conditions d’émergence de nouvelles modalités organisationnelles, en particulier la création d’un nouveau groupe d’acteurs, les enseignants référents pédagogiques (ERP). Il s’agit d’une équipe intermédiaire située entre la direction et l’ensemble des autres formateurs et des tuteurs de stage. À cette première médiation institutionnelle s’ajoute la création d’un « artefact technique », appelé Groupe d’entrainement à l’analyse des pratiques en rééducation (GEAPR)[1]. Aussi le recours à la sociologie de la traduction s’avère un cadre théorique particulièrement pertinent pour comprendre comment chacun des acteurs reçoit, reformule et s’engage dans une dynamique de changement et quels sont les obstacles et les réaménagements qui surviennent.
L’accompagnement par les chercheurs est ici très précieux pour suivre l’évolution du fonctionnement de ce groupe de pilotage de la réforme, formé par l’équipe d’ERP (qui passe de 7 à 10 formateurs) et par les deux responsables de direction. Leur politique de communication à l’ensemble des acteurs de la formation vise à les informer et les inciter à s’inscrire à l’université en sciences de l’éducation, pour mieux répondre à l’exigence du mémoire de recherche et de la posture réflexive attendue en ce qui concerne l’analyse des pratiques. Éric Maleyrot pointe les limites de ces transformations et la difficulté de passer d’un leadership instructionnel à un leadership transformationnel. L’autre nouveauté majeure concerne le dispositif réflexif GEAPR qui révèle des résistances au changement tant chez les formateurs, à qui cela demande d’assumer une fonction de modérateur en privilégiant l’animation des interactions entre les étudiants au détriment d’une intervention uniquement centré sur les gestes techniques du MK, que chez les étudiants, qui doivent accepter de construire leurs savoirs pratiques par la réflexion sur l’action et l’observation, et ainsi renoncer à obtenir des réponses immédiates.
D’un point de vue clinique, la troisième partie focalise l’analyse de l’impact du GEAPR sur l’évolution des postures des formateurs et les difficultés et bénéfices rencontrés par les étudiants. Elle fournit des perspectives essentielles pour comprendre comment, au fur et à mesure des trois années de l’utilisation de ce dispositif, les différents acteurs vont pouvoir s’approprier, en transformant le maniement de certains critères d’observation et des modes de répartition des étudiants (observateurs, patient simulé, MK simulant) ainsi que de l’emploi des séquences temporelles, de nouvelles façons de former et d’apprendre en intériorisant une distanciation nécessaire favorisée par un travail de groupe réflexif. La distinction qu’introduit Éric Maleyrot entre instrumentalisation et instrumentation pour rendre compte du changement qui s’opère chez les formateurs dans leur manière d’utiliser ce dispositif (p. 183-193) interroge le statut de ce dispositif initialement conçu par la direction, dans une perspective socio-constructivste. Les réajustements effectués par la suite illustrent la dynamique possible d’un tel dispositif. Que ce soit les hésitations ou les difficultés à proposer des situations de simulation professionnelles, ou les atermoiements des formateurs à intervenir sur les questions techniques en répondant à la demande des étudiants, la recherche a permis de comprendre comment ces limites et ces obstacles ont pu être surmontés à partir de la diversité des stratégies des acteurs en présence.
Cette recension est loin de rendre compte de tous les enjeux multiples, épistémique sociologique, institutionnel, identitaire d’une telle étude pour saisir l’impact de cette réforme. La richesse des analyses ne peut qu’inviter le lecteur à explorer lui-même les autres aspects de ce livre passionnant.
[1] Directeur et directeur adjoint s’inspirent, pour concevoir ce dispositif , du GEASE (groupe d’entrainement à l’analyse des pratiques) qu’ils ont eu l’occasion de tester lors de leur passage à l’université.
Mobiliser et développer des compétences interactionnelles en situation de travail éducatif
Par Bruno Grave, Université de Montpellier, France
 L’ouvrage présenté rend compte du développement d’un programme, soutenu par le Fonds national suisse de la recherche, associant des universitaires de Neuchâtel et de l’équipe Interaction & Formation de l’université de Genève, et de multiples acteurs professionnels : école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance, structures d’accueil de la petite enfance (espaces de vie, crèches). Le travail éducatif auprès de jeunes enfants, qui a fait l’objet de peu d’études en sciences de l’éducation et de la formation, est ici au cœur de la recherche. L’activité ou plutôt la coactivité analysée, est envisagée ici comme complexe, associant une diversité de situations nécessitant la mise en œuvre de ressources par des professionnels de l’éducation, pour les animer, les réguler, les coordonner, en interagissant dans des environnements matériels, humains, historiquement situés. L’ouvrage (collectif) rassemble huit chapitres distribués en trois parties thématiques. L’ensemble s’inscrit dans une didactique professionnelle des métiers adressés à autrui, plus précisément dans une mouvance interactionnelle en analyse du travail. L’ouvrage, sous la direction de L. Filliettaz et de M. Zogmal, réunit, pour sa rédaction, cinq autres chercheurs.
L’ouvrage présenté rend compte du développement d’un programme, soutenu par le Fonds national suisse de la recherche, associant des universitaires de Neuchâtel et de l’équipe Interaction & Formation de l’université de Genève, et de multiples acteurs professionnels : école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance, structures d’accueil de la petite enfance (espaces de vie, crèches). Le travail éducatif auprès de jeunes enfants, qui a fait l’objet de peu d’études en sciences de l’éducation et de la formation, est ici au cœur de la recherche. L’activité ou plutôt la coactivité analysée, est envisagée ici comme complexe, associant une diversité de situations nécessitant la mise en œuvre de ressources par des professionnels de l’éducation, pour les animer, les réguler, les coordonner, en interagissant dans des environnements matériels, humains, historiquement situés. L’ouvrage (collectif) rassemble huit chapitres distribués en trois parties thématiques. L’ensemble s’inscrit dans une didactique professionnelle des métiers adressés à autrui, plus précisément dans une mouvance interactionnelle en analyse du travail. L’ouvrage, sous la direction de L. Filliettaz et de M. Zogmal, réunit, pour sa rédaction, cinq autres chercheurs.L’introduction (Filliettaz & Zogmal) situe l’ancrage épistémologique adopté pour l’étude : il s’agit d’analyser la coactivité dialogale dans laquelle un professionnel de l’éducation interagit avec un ou plusieurs interlocuteurs (Pastré, 2011). Les propriétés du travail interactionnel des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants sont encore mal connues et le but de la recherche engagée est de mieux cerner ce travail, notamment en ce qu’il requiert de mobiliser et de développer des compétences interactionnelles. Deux objectifs sont alors poursuivis : rendre visibles la nature et les particularités de ces compétences interactionnelles, comprendre comment elles se construisent et se développent dans des dispositifs de formation professionnelle en alternance. Le langage est ici conçu comme praxéologique, contextualiste, intersubjectif et multimodal.
Première partie : Le travail éducatif en question.
Cette première partie problématise la recherche effectuée et en présente les tenants méthodologiques ; elle situe l’engagement et les interactions verbales comme exigences du travail des professionnels de l’enfance et définit la notion de compétence interactionnelle.
Le chapitre I, de Fillietaz et Zogmal, restitue, d’un point de vue historico-social les enjeux de l’accueil de la petite enfance, puis de la formation professionnelle des éducatrices et éducateurs eu égard à la qualité de l’accueil et du travail éducatif exigés. Cette qualité du travail est articulée à la notion de compétence professionnelle, pour laquelle un développement théorique est apporté. La particularité du travail éducatif constitué par sa nature interactionnelle et langagière est ensuite mise en évidence pour déployer le concept de compétence interactionnelle, au centre de l’étude.
Le chapitre II pose et précise la démarche de recherche vidéo-ethnographique envisagée. Fillietaz et Losa restituent les questions, les problématiques et le recueil de données empiriques opéré durant quatre années en contexte genevois. On y précise notamment la sélection des situations emblématiques retenue pour l’étude : activités éducatives, jeux libres, réunions, collations ou moments de transitions. Ces situations emblématiques sont observées dans différents contextes : pratique accompagnée en stages, formation en école professionnelle, élaborations réflexives en entretiens collectifs… Les périmètres distincts d’observation permettent d’étudier les situations de travail des éducatrices et éducateurs sous plusieurs angles : pratiques exercées, pratiques enseignées, pratiques réfléchies… Le traitement des données est ensuite présenté : transcription, démarches d’analyse (cas singuliers, collections, trajectoires…). Les processus intersubjectifs d’ajustements, de coordination sont au centre des analyses : ils sont à la fois objet et méthode de recherche. L’analyse se présente en différents formats : analyse de cas singuliers (intelligibilité des processus à l’œuvre), collection de situations (systématicité des processus à l’œuvre), trajectoires situées (transformations observables sur un temps plus long).
Deuxième partie : Mobiliser des compétences interactionnelles dans le travail éducatif.
Cette deuxième partie, organisée en quatre chapitres, met en évidence le caractère complexe, multimodal, collectif et dynamique des compétences interactionnelles mises en œuvre par les éducatrices et éducateurs auprès des enfants.
Le chapitre 3 (Filliettaz) a pour objet les activités éducatives dites « structurées ». L’animation d’un jeu de cartes, en situation, est ainsi analysée et montre les ressources interactionnelles mobilisées par les acteurs pour délimiter les unités d’action de l’activité menée. L’analyse met ainsi en lumière l’ordonnancement et la structuration du travail mené par les compétences interactionnelles.
Le chapitre 4 (Zogmal) porte sur les activités de jeux libres et s’intéresse aux « ingrédients » contribuant à la mise en œuvre de ce type de situations et notamment aux compétences interactionnelles mobilisées par les acteurs à cette occasion. L’analyse est longitudinale et reprend les composantes de la situation de jeux libres : espace, matériel, positionnement des acteurs, sollicitations des enfants, aux réponses des professionnels, aux régulations apportées pour mener au bout cette activité. Sont mises en exergue, les articulations entre prises d’initiatives des enfants, leurs conduites autonomes et les sollicitations, régulations des éducateurs. Là encore, il s’agit de faire advenir un « ordre interactionnel » permettant de construire des significations partagées.
Le chapitre 5 (Markaki-Lothe & Rémery) s’intéresse aux situations d’interstices et de transition et aux compétences interactionnelles qu’elles requièrent. Les problèmes rencontrés lors des transitions et surtout les processus d’ajustement et de coordination conduits en collaboration entre éducateurs sont mis en lumière. L’accent est porté, dans l’activité professionnels/stagiaires, sur le soutien apporté par les premières aux secondes. L’analyse des pratiques (vidéo-formation) présente des intérêts forts pour la professionnalisation, en général, et la gestion des transitions, en particulier, ces dernières se structurant au cours de micro-moments, ayant chacun leur temporalité.
Le chapitre 6 (Zogmal) est consacré à l’observation des enfants par les éducateurs et éducatrices et aux compétences interactionnelles mobilisées dans ce cadre. L’observation est d’abord présentée dans une perspective interactionnelle puis une séquence est ensuite analysée pour mettre en évidence les « connaissances » construites sur les conduites et les compétences des enfants. Le « savoir voir » construit est mis ensuite au service de la coordination, de l’orientation et de la régulation des pratiques dans une perspective interactionnelle (partagée entre les professionnels) y compris formative (« faire voir » aux collègues débutants).
Troisième partie : Construire et développer des compétences interactionnelles dans le travail éducatif.
Cette dernière partie vise la compréhension du développement des compétences interactionnelles en situations de travail (stages). Il s’agit notamment d’étudier les liens entre effectuation du travail et moments de formation : l’activité tutorale (entretiens pédagogiques, accompagnement en situations) fournit alors les données empiriques soumises à l’analyse.
Le chapitre 7 (Trébert) porte sur l’accompagnement, en situations, des éducatrices débutantes par leurs collègues expérimentées. Le cas rapporté et étudié met en évidence l’aménagement réalisé progressivement par la tutrice pour permettre à la stagiaire d’interagir avec les enfants, jusqu’à adopter une posture d’observatrice. La fin de ce chapitre montre tout l’intérêt de la démarche d’analyse interactionnelle dans la compréhension du travail des tuteurs voire des formateurs qui accompagnent les étudiants en formation, y compris pour d’autres métiers adressés à autrui (social, santé).
Le chapitre 8 (Durand) s’intéresse aux interactions entre étudiantes-stagiaires en contexte éducatif. Pour l’auteure, la construction d’une posture professionnelle d’éducatrice implique l’acquisition d’une compétence interactionnelle spécifique qui est celle de demander de l’aide aux collègues de travail. Les analyses effectuées montrent que les interactions d’aide et les conditions de leur réalisation, sur la durée, constituent des repères pour la construction de la professionnalité de l’apprenant. Un outil pour l’analyse en formation est présenté : l’événement professionnel signifiant pour la formation (EFSI).
Dans la conclusion de l’ouvrage, Filliettaz et Zogmal resituent l’objet d’étude que constituent les compétences interactionnelles dans la complexité de leur exercice, notamment dans des rapports d’interdépendance multiples. La démarche de l’ouvrage est redéployée en mettant l’accent sur l’importance à la construction et à l’attribution de significations partagées par les acteurs, dans l’organisation et l’enchaînement même des activités. La notion « d’ordre social partagé » (ordre négocié) est évoquée pour désigner le construit collectif réalisé par les acteurs en étroite interdépendance, en négociation continuelle, par les compétences interactionnelles à l’œuvre. Les auteurs concluent avec les propriétés d’hybridité et de mimétisme démontrées dans l’étude entre activité professionnelle et processus de formation. L’analyse interactionnelle est ainsi un puissant outil de formation.
L’ensemble de l’ouvrage est une mine de données théoriques et méthodologiques pour des recherches à venir, dans d’autres champs professionnels (santé, social) de métiers adressés à autrui. L’analyse interactionnelle, ainsi posée et déployée, ouvre des perspectives. Outre celle de la construction de compétences interactionnelles dans l’exercice de l’activité de travail, celles relatives à la compréhension, dans un « grain fin », de la construction des apprentissages professionnels en situation de travail (co-apprentissage, tutorat, compagnonnage…) semblent particulièrement prometteuses pour des recherches à venir.
La professionnalisation en débat : entre intentions et réalisations
Ouvrage dirigé par Najoua Mohib et Stéphane Guillon. Éditeur : Peter Lang (2018).
Par Jean-François Plateau, Université de Strasbourg, France
 La préface de Richard Wittorski lance le débat principalement sur l’aspect polysémique du concept, que démêleront les 15 contributeurs de l’ouvrage coordonné par Najoua Mohib et Stéphane Guillon : La professionnalisation en débat – Entre intentions et réalisations. Les rapports liant la formation, l’éducation, le travail et leurs acteurs y sont visités analysés, pesés, selon différents éclairages et les tensions qu’ils génèrent. La première de ces tensions, révélée dans l’introduction par Najoua Mohib et Valérie Ledermann, oppose les normes de la société libérale aux valeurs humanistes de l’éducation. La professionnalisation, en devenant le remède au chômage, discrédite le rôle du système éducatif.
La préface de Richard Wittorski lance le débat principalement sur l’aspect polysémique du concept, que démêleront les 15 contributeurs de l’ouvrage coordonné par Najoua Mohib et Stéphane Guillon : La professionnalisation en débat – Entre intentions et réalisations. Les rapports liant la formation, l’éducation, le travail et leurs acteurs y sont visités analysés, pesés, selon différents éclairages et les tensions qu’ils génèrent. La première de ces tensions, révélée dans l’introduction par Najoua Mohib et Valérie Ledermann, oppose les normes de la société libérale aux valeurs humanistes de l’éducation. La professionnalisation, en devenant le remède au chômage, discrédite le rôle du système éducatif.
L’ouvrage partagé en 3 parties fait état en premier lieu des enjeux de la professionnalisation entre travail et formation. Il évoque ensuite les défis relevés par l’enseignement supérieur et se concentre en dernier lieu sur ses effets auprès de deux types d’acteurs : les enseignants et les travailleurs sociaux.
Patricia Champy-Remoussenard évoque à la fois les enjeux, mais aussi les dangers de la flexibilité prônée par les entreprises. D’un côté, la recherche, autour de l’analyse de l’activité dynamise la production de formation, en réponse à un besoin social. De l’autre, l’adaptation réclamée par la mutation du travail génère pour l’individu de l’incertitude, voire de l’insécurité. Elle observe ainsi un « recul du collectif », par le fait que les besoins individuels sont parfois évincés, au nom de la flexibilité.
La contribution de Philippe Maubant et Lucie Roger, s’intéresse aux métiers adressés à autrui, et plus spécifiquement au travail éducatif touchant aux métiers de la formation, tout en les inscrivant dans leur contexte politique et institutionnel, tant du point de vue de l’acteur (le professionnel) que du bénéficiaire. Le système scolaire au Québec a intégré l’éducation des adultes par une pédagogie spécifique, dès les années 1990, et la formation professionnelle poursuit l’objectif d’adapter la main-d’œuvre à la réalité économique. La mise en place d’ingénieries de formation en réponse aux demandes des entreprises de production a pris de l’essor. Cela induit un changement du métier de formateur ; il devient plutôt coach, conseiller, coordinateur et voit sa fonction éducative s’évaporer.
La note de lecture de Solveig Fernagu Oudet de l’ouvrage de de Demazière, Roquet et Wittorski intitulé « La professionnalisation mise en objet », invite à réfléchir, à ce stade, sur la relation entre l’activité, la situation et le sujet dans le processus de professionnalisation, comme de la distance qui sépare professionnalisation imposée et désirée et la remise en cause de la notion de « métier ».
Marc Ponsin finalise cette première partie en mettant en relief le rapprochement du concept de professionnalisation avec celui de gestion, fruit des évolutions législatives régissant la formation professionnelle depuis le début du millénaire (DIF, VAE, etc.) en faisant émerger le concept de « flexicurité ». Les besoins en formation grandissent, les budgets diminuent et les technologies modifient les modes d’intervention et d’apprentissage. S’appuyant sur les idées de Wittorski, il prône le dépassement des situations formelles et l’usage de l’alternance, de l’analyse des pratiques, et la combinaison de différentes méthodes de formation, dont l’intégration de l’enseignement à distance. Cette souplesse permet de répondre au besoin d’individualisation de la formation continue.
Michel Sontag amorce la deuxième partie de l’ouvrage, en précisant que la formation professionnelle par alternance en milieu universitaire fait partie d’un héritage, la médecine ayant été depuis le 11ème siècle un précurseur. Dans les domaines économiques du secondaire et du tertiaire les DUT sont créés en 1966, puis les DESS (1975) et les licences professionnelles (1999). La loi du 23 juillet 1987, en ouvrant la voie de l’apprentissage du niveau V au niveau I, donne l’opportunité de plus d’autonomie financière aux universités. Les filières professionnelles, aux objectifs tournés vers les compétences pour la formation d’experts, avec une réflexion se faisant « sur et dans l’action », sont plus sélectives que les filières universitaires classiques fondées sur des modèles théoriques. L’exemple de la formation d’ingénieur par alternance à l’INSA permet à l’apprenant d’être salarié. Il montre aussi l’importance du rôle du responsable pédagogique, chargé de faciliter le lien entre les compétences recherchées par l’entreprise (techniques et comportementales), mises en œuvre par le tuteur et les connaissances scientifiques indispensables à l’apprenti ingénieur pour valider son statut. Cette analyse est confortée par Annie Cheminat avec une perspective « adéquationniste ». « La professionnalisation en milieu universitaire » satisfait, pour elle, à la fois les employeurs et les étudiants, peu nombreux à accéder aux carrières académiques, dans la construction de leur projet professionnel. Le processus de Bologne, avec les ECTS, la formation des langues, l’usage des technologies informatiques et le développement de compétences transversales inclus dans les programmes de licence, favorise également l’employabilité des étudiants.
Cependant, comme l’affirme Vanessa Boléguin, le taux d’emploi des personnes diplômées faiblit, en accréditant la thèse « inadéquationniste » en donnant plus d’espace au segment secondaire et donc à la précarité des contrats de travail. Cela induit le réflexe de professionnaliser l’enseignement supérieur, en substituant les savoirs pratiques à ceux académiques, et permet de réduire en même temps les coûts de recrutement et de formation, donc salariaux, des entreprises. Le glissement qui s’opère ainsi du segment primaire vers le secondaire limite l’accès à la formation continue des salariés.
La note de lecture de Charlène Millet, « La professionnalisation : vers un nouveau façonnage de l’Université ? » réitère la question du dilemme de l’Université entre le besoin de répondre à l’insertion professionnelle des étudiants et celui de produire des savoirs académiques. Elle annonce la troisième partie de l’ouvrage, centrée sur la professionnalisation des acteurs. Jean-François Marcel amorce le débat avec l’exemple des professeurs de l’enseignement agricole public. Pour lui, l’enseignement demeure un métier qui s’apprend, tout en nécessitant l’acquisition du Master, garant de connaissances solides. Mais en se retrouvant directement en poste sans y être vraiment préparés, les enseignants, dont le travail s’est transformé, constatent un manque de moyens. Une meilleure reconnaissance de leur statut, des passerelles entre l’enseignement professionnel et le MASTER et le suivi d’objectifs de socialisation permettraient de donner à l’enseignant un réel pouvoir d’éduquer.
François Laspeyres, reprend à ce propos les trois modèles ayant contribué à la formation des enseignants. Le premier modèle, « successif » (1991 à 2009), permettait par l’alternance une analyse réflexive et par un travail pluri-catégoriel de créer de l’interaction entre les contenus et les acteurs. Le second modèle, « simultané », à partir de 2009 en imposant l’obtention du Master et du CAPES, a généré du bachotage et une prise de poste sans avoir été vraiment mis en situation d’enseignement. La suppression de l’année de stage en alternance a participé à ce que l’auteur qualifie de régression, avec son lot d’abandons. À partir de 2013, le modèle « intégratif » a rétabli l’alternance en donnant aux étudiants le statut de fonctionnaire stagiaire. L’intégration des organismes de formation dans les Universités concilie finalement les savoirs académiques et pratiques liés à l’enseignement.
La note de lecture sur « Les lumières du praticien réflexif » de Tardif, Borges et Malo, réalisée par Claude-Alexandre Magot, donne ici à la réflexivité tout son sens en référence à l’approche de Schön.
Christiane MIAS poursuit cette réflexion avec la multiplicité des professionnels du travail social. Chacun ne donne pas le même sens au contexte, les repères diffèrent selon les corps professionnels avec des points communs (transmission, rappel du passé et réflexivité) devant surmonter les différences, comme la co-construction de représentations partagées entre les interventions thérapeutiques et éducatives autour d’un même projet. Mais le sentiment de contrôle sur l’action est indispensable pour le professionnel devant être reconnu comme tel dans et par son environnement. L’interrogation permanente individuelle et collective de ces dimensions, sens, repères et contrôle sur l’action, favorisée par l’analyse des pratiques permet de gommer les différences induites par les différentes interventions.
Dominique Besnard, complète ce regard sur le travail social. Il prend appui sur la méthode clinique, en référence au courant de la psychothérapie institutionnelle. Observation du sujet, temps nécessaire à sa mise en confiance et travail collectif entre professionnels en sont le fondement. Les formations des travailleurs sociaux se basent sur des « savoirs d’action », l’alternance et l’analyse des pratiques, avec comme spécificité, l’apprentissage collectif des situations de travail, pour mieux amorcer le travail en équipe et améliorer leurs compétences individuelles. Mais leur multiplicité les rend plutôt techniciens, avec l’inconvénient de donner peu ou pas d’importance au temps nécessaire à la construction d’une relation avec le sujet, et de mettre en avant la prédiction au lieu de la prévention. La solution, pour cet auteur, est de pouvoir articuler les savoirs disciplinaires avec ceux issus de l’expérience et de favoriser l’approche pluriprofessionnelle, car celle pluridisciplinaire technicise trop les interventions.
Cet ouvrage est une mine de réflexion au sujet de la professionnalisation et des représentations qu’il génère. La conclusion amenée par l’un de ses coordinateurs, Stéphane Guillon élargit le débat avec un regard lucide sur les raisons qui écartent de l’emploi les « décrocheurs » du système éducatif, plutôt que les diplômés. Mais le « risque de “cannibalisation” par les formations professionnalisantes me semble être exagéré. Connaissances et compétences s’assimilent réciproquement. Les formations (pré) professionnalisantes retiennent plus facilement les “décrocheurs”. L’alternance abandonnée puis reprise par la formation des enseignants en France montre sa force, au même titre que l’alternance intégrative dans la formation des travailleurs sociaux. Il est sans doute temps d’indifférencier les statuts du savant et de l’expert, comme étant des professionnels au service de leur entreprise, des travailleurs en tout cas, œuvrant pour l’utilité sociale. Celle de s’intéresser aux “fugueurs” du système éducatif, commence sans doute aussi par une réconciliation des systèmes éducatif et économique portés par des valeurs humanistes fortes et fondées sur l’égalité des chances, et celle aussi du vivre ensemble.
 Pionnières de l’éducation des adultes : perspectives internationales
Pionnières de l’éducation des adultes : perspectives internationales
Françoise Laot et Claudie Solar (2018). (Dir.). Éditeur : L’Harmatan.
Par Pierre Hébrard, Université de Montpellier, France
Cet ouvrage collectif, issu d’un symposium du REF (Réseau de Recherche sur l’Éducation et la Formation), vient combler une lacune : la méconnaissance, pour ne pas dire l’ignorance, très largement partagée concernant le rôle d’un certain nombre de femmes dans le développement de l’éducation des adultes au 19e et au début du 20e siècle. Les onze pionnières qui font l’objet de cet ouvrage ont toutes consacré leur vie au combat pour l’éducation, notamment celle des jeunes filles et des femmes, à une époque où elle commençait à se généraliser, mais restait encore très inégale. Leur engagement, malgré des convictions politiques et religieuses différentes, visait à la fois la justice sociale, l’éducation pour tous à tous les âges et « l’élévation de la femme », par le moyen d’une éducation morale, intellectuelle et aussi, souvent, d’une formation professionnelle. Elles étaient, de ce fait, des militantes féministes, certaines plus radicales, comme Jeanne Deroin (1805-1894) qui défendait l’égalité des droits des citoyennes et des citoyens, d’autres plus modérées, comme Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905) qui préconisait une éducation morale et hygiéniste des femmes des classes populaires. Après une préface de Rebecca Rogers, l’introduction Françoise Laot et Claudie Solar, directrices de l’ouvrage, situent les travaux des auteur. e. s dans le cadre de l’histoire des femmes en Europe et aux États-Unis et du tournant biographique de cette discipline. Elles ouvrent ainsi un champ quasi inexploré de l’histoire de l’éducation des adultes, au moyen de ces biographies de pionnières.
Elles soulignent en particulier le rapport au savoir – la soif de connaissances – et le rapport au travail, très en avance sur ceux de leurs milieux d’origine, qui caractérisait ces femmes, toutes nées au 19e siècle. Leur ouvrage a une dimension internationale, les onze pionnières venant de six pays différents : la France, la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Pologne et les États-Unis.
Chaque chapitre de l’ouvrage comprend deux parties : la première présente de façon détaillée la biographie d’une de ces pionnières, et la situe dans son contexte socio-historique, économique et politique ; la seconde analyse leurs activités et leurs idées dans le domaine de l’éducation des adultes et plus largement leur conception de la justice sociale et du rôle de la femme dans la société et dans le monde du travail. Les neuf auteur. e. s de ces chapitres – huit sont des femmes – s’appuient sur des sources solides, des recherches de première main dans des archives, des travaux d’historiens et, pour certaines, des biographies antérieures, lorsqu’elles étaient disponibles.
Ils montrent, pour chacune de ces femmes, leur combat commun pour l’éducation de toutes et de tous, mais aussi leurs spécificités, liées à leurs milieux d’origine, à la situation socio-économique et politique du pays où elles se trouvaient, à leurs convictions, leurs choix et leurs priorités. Ainsi, Françoise Laot retrace la lutte pour l’égalité et la citoyenneté des femmes de Jeanne Deroin, lutte qui la conduira en prison en France, puis en exil en Grande-Bretagne. Elsa Roland détaille l’action pour une éducation spécifiquement féminine, éducation morale et hygiéniste, préconisée par Isabelle et Zoé Gatti de Gamond. Marianne Thivend rend compte du développement de la formation professionnelle comptable et commerciale des femmes initié par Élise Luquin à Lyon, puis dans toute la France.
L’éducation civique pour la démocratie défendue par Mary Follett aux États-Unis, au moyen des cours du soir, des centres sociaux communautaires et des groupes de voisinage, est décrite et analysée par Claudie Solar. Marie-Elise Hunyadi pour sa part, met en lumière la lutte pour l’accès des femmes aux études et aux carrières universitaires de Caroline Spurgeon et Virginia Gildersleeve en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ainsi que l’action de la Fédération internationale des Femmes diplômées des Universités, créée par ces deux femmes en 1919. Le chapitre de Joëlle Droux traite de l’œuvre de Marguerite Champendal, en Suisse, en faveur de la formation des mères des milieux populaires et de la formation professionnelle des infirmières. Jacques Eloy aborde le développement de l’éducation mutuelle et des centres sociaux sous l’impulsion de Marie-Jeanne Bassot dans les quartiers populaires de la région parisienne. Ewa Marynowicz-Hekta et Françoise Laot étudient la création de l’enseignement de la pédagogie sociale dans les universités polonaises à l’initiative d’Helena Radlinska. Enfin, Marie-Thérèse Coenen rend compte de l’organisation du syndicalisme féminin et des cercles d’études par Victoire Cappe en Belgique.
Ce trop rapide survol n’a d’autre but que de donner une idée de la diversité des aspects de l’éducation des adultes, notamment des femmes et des jeunes filles, que ces différents chapitres abordent à travers ces biographies et les analyses qui les accompagnent. Ces femmes, pionnières de l’éducation des adultes, de l’éducation populaire et de l’émancipation féminine, méritaient qu’un ouvrage savant, mais d’une lecture très agréable, leur soit consacré. Il devrait désormais trouver sa place dans la bibliothèque de toutes celles et de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des femmes et à celle de l’éducation des adultes
Professionnalisation des métiers du cirque : des processus de formation et d’insertion aux épreuves identitaires
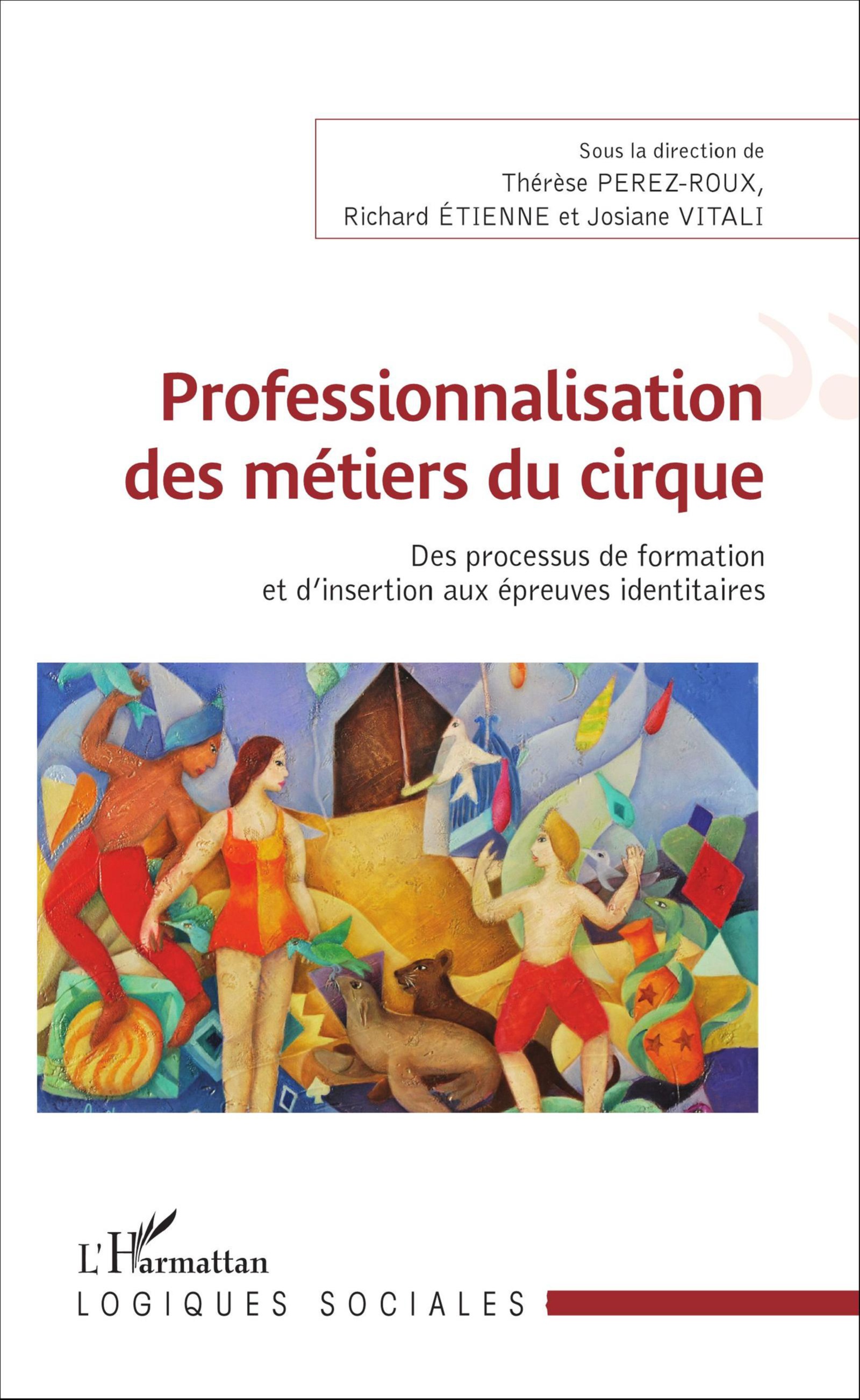 Thérèse Perez-Roux, Richard Étienne et Josiane Vitali (2016). (Dir.). Éditeur : L’Harmattan (collection Logiques sociales).
Thérèse Perez-Roux, Richard Étienne et Josiane Vitali (2016). (Dir.). Éditeur : L’Harmattan (collection Logiques sociales).
Par Jean Bernatchez, Université du Québec à Rimouski (UQAR), Canada
L’ouvrage dans son contexte
Professionnalisation des métiers du cirque. Des processus de formation et d’insertion aux épreuves identitaires paraît chez L’Harmattan en 2016, dans la collection Logiques sociales dirigée par Bruno Péquignot, sociologue des arts et de la culture et professeur de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Cette collection réunit des chercheurs et des praticiens et elle entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l’action sociale : « En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d’un terrain, d’une enquête ou d’une expérience qui augmentent la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui proposent une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques » (p. 2). Le livre n’a pas la prétention d’innover sur le plan théorique ou méthodologique, mais il atteint son objectif de rendre compte d’expériences et de pratiques qui contribuent à une meilleure compréhension d’un phénomène social riche sur le plan symbolique et signifiant d’un point de vue artistique, voire économique : la professionnalisation des métiers du cirque présentée comme un enjeu et comme un défi.
L’ouvrage est un collectif dirigé par Thérèse Perez-Roux, professeure en sciences de l’éducation de l’Université Paul-Valéry de Montpellier, dont les travaux portent sur la professionnalisation des enseignants et sur les dynamiques identitaires des acteurs de l’éducation; par Richard Étienne, professeur émérite en sciences de l’éducation de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Montpellier, réputé formateur d’enseignants qui poursuit ses travaux sur le changement, l’encadrement et la formation; et de Josiane Vitali, doctorante en sciences de l’éducation qui travaille sous la supervision de Richard Étienne sur les pratiques de loisirs des arts du cirque, après avoir étudié le nomadisme dans la formation supérieure des artistes de cirque en France. Les trois auteurs sont associés au Laboratoire Interdisciplinaire des Recherches en Didactique Éducation Formation (LIRDEF) de Montpellier. Dix autres collègues signent les textes de l’ouvrage, organisé en deux parties et neuf chapitres. La première partie traite de l’insertion et de la professionnalisation eu égard aux risques de déprofessionnalisation dans les métiers du cirque. La deuxième partie porte sur les identités professionnelles des métiers du cirque. L’environnement privilégié est essentiellement celui de la France.
Le contenu de l’ouvrage
En guise de mise en bouche, Valérie Fratellini se confie à Josiane Vitali. Fille d’Annie Fratellini, chanteuse et comédienne devenue clown, et de Pierre Granier-Deferre, un réalisateur opposé à la Nouvelle Vague, Valérie Fratellini fait carrière au cirque avant d’assurer la direction pédagogique de l’Académie Fratellini, fondée en 1974 (sous le nom d’École nationale du cirque) par sa mère et son conjoint, Pierre Etaix, figure charismatique du cirque, mais aussi du cinéma, entre autres aux côtés de Jacques Tati. L’Académie Fratellini porte aujourd’hui le projet d’un centre de formation supérieure aux arts du cirque qui délivre le Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque (niveau licence) après trois ans de formation. L’école que connaît Valérie Fratellini dans les années 1970 est toutefois sans cursus ni diplôme. Elle permet d’approcher l’acrobatie et le mouvement du corps, compétences utiles pour le théâtre. Raymond Devos et Jean-Louis Barrault soutiennent alors les époux Fratellini-Etaix dans leur projet.
Les trois directeurs de l’ouvrage signent ensuite l’introduction qui rend compte que la professionnalisation dans les arts du cirque ne va pas de soi. Ils rappellent que l’initiative du livre s’inscrit dans le cadre de deux symposiums tenus en 2011 et 2014. Le premier rend possible la publication en 2014 d’un livre intitulé Quelle formation professionnelle supérieure pour les arts du cirque ? Le second conduit au présent ouvrage. Les auteurs prennent soin de bien définir les concepts-pivots. Inspirés par Raymond Bourdoncle, ils définissent la professionnalisation comme l’articulation de trois processus : l’amélioration du statut d’une activité et sa reconnaissance sociale; ses formes de socialisation, entre autres les valeurs et les normes défendues collectivement par le groupe des professionnels; le processus d’amélioration des capacités et de rationalisation des savoirs mis en œuvre dans l’exercice de la profession. Ce processus constitue une avancée qui permet de rendre visibles les métiers artistiques dans le champ social et culturel, croient-ils, mais il porte aussi sa part de possibles dérives pouvant amorcer des formes de déprofessionnalisation. Se référant cette fois à Lise Demailly et à Patrice de la Broise qui se sont consacrés à trois cas empiriques (les postiers, les universitaires et les psychiatres), ils estiment que la déprofessionnalisation se manifeste par la souffrance et la perte de repères avec, entre autres phénomènes, une augmentation des régulations de contrôle par la hiérarchie qui fragilisent les pratiques autonomes des acteurs.
Richard Étienne inaugure la première partie de l’ouvrage avec le chapitre 1 portant sur les ambiguïtés de la professionnalisation et le recours au professionnel. Sa contribution est riche de références classiques (Kant, Freud et Lévi-Strauss) et contemporaines, celles-là ayant trait entre autres aux compétences des acteurs, au « savoir agir en situation » (Le Boterf) dans les « métiers de l’interaction humaine » (Jorro). Il rappelle la difficulté à enfermer les professions artistiques dans un ensemble de normes, l’autonomie de l’acteur pouvant y être étouffée. Une profession s’auto-organise avec un ordre professionnel qui détermine des règles et gère des sanctions; avec un code de déontologie; avec une expertise; et avec une obligation de moyens imposant une formation tout au long de la vie qui assure un monopole par le biais d’une cooptation de nature universitaire. Cette cooptation entraîne une reproduction, prélude au corporatisme qui fait que la profession se préoccupe plus des intérêts de ses membres que de l’intérêt général. Le cirque connaît plusieurs évolutions et révolutions croit l’auteur, dont la plus récente concerne le développement d’une formation diplomante à ses métiers. Il présente quatre modèles de formation aux métiers du cirque : familial, en école, libéral (laissé à la discrétion des acteurs) et universitaire. Confier cette formation à l’enseignement supérieur représente un progrès par rapport au modèle familial, mais cette institutionnalisation peut avoir des conséquences négatives : banalisation liée à une organisation normée dont la tradition est la seule justification; uniformisation, alors que la transgression des normes est souvent associée à l’activité de création; ambiguïté autour de la notion de risque puisque plusieurs pratiques « risquées » constituent l’essence du spectacle de cirque. En conclusion, Richard Étienne dit préférer parler de développement professionnel plutôt que de professionnalisation : « Je préconise d’éviter de tomber dans le piège de la professionnalisation/déprofessionnalisation pour aller vers une « professionnalité des métiers du cirque » qui permettra de formaliser puis développer des gestes professionnels spécifiques à ces métiers dans le cadre d’un accès de plus en plus aisé et instantané aux performances les plus spectaculaires mais aussi les plus « convenables » sur les plans artistique, historique et éthique » (p. 55).
Quatre autres contributions alimentent la première partie de l’ouvrage. Elles rendent compte d’une intention de professionnalisation des métiers du cirque et de sa traduction dans des dispositifs particuliers. Josiane Vitali consacre le chapitre 2 au secteur de l’animation dans les écoles de sport et loisir qui se pratique en amont de l’entrée dans un métier du cirque. Elle dresse un historique du milieu de l’animation en France avant de s’intéresser à l’alternative entre professionnalisation et socialisation professionnelle. « L’animation doit-elle faire le deuil des valeurs militantes qui sont à son origine ou se consacrer à une logique entrepreneuriale qui en assurera la survie ? » (p. 77). Elle espère qu’un troisième symposium permettra de répondre à la question. Stéphane Simonin, directeur de l’Académie Fratellini depuis 2011, propose dans le chapitre 3 le portrait très descriptif de la formation offerte : cours collectifs, accompagnement individuel, stages de travail approfondis autour d’un thème et cours offerts par l’Université Paris 8 dans le cadre de la licence en théâtre. Le chapitre 4 permet à Marine Cordier de s’intéresser à la question du genre dans les métiers du cirque. Elle est maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre et titulaire d’un doctorat en sociologie avec une thèse portant sur la professionnalisation des métiers du cirque. Les femmes représentent 33 % des professionnels du cirque, mais plusieurs réussissent à ne pas s’enfermer dans des spécialités typiquement féminines. Le « plafond de verre » joue néanmoins, observe l’auteure, qui remarque que moins de 30 % des femmes sont impliquées dans des fonctions de création ou de direction artistiques. Barbara Appert-Raulin, responsable de la formation permanente au Centre national des arts du cirque en Châlons-en-Champagne, décrit dans le chapitre 5 le contenu des référentiels d’activités et de certification dans les écoles de cirque. Ces écoles sont nombreuses, jeunes et elle cherchent leur parcours, leurs pédagogies et leurs univers artistiques, croit l’auteure. Un Diplôme d’État de professeur de cirque a notamment été créé en 2013.
La seconde partie de l’ouvrage s’amorce avec le chapitre 6 et une contribution de Thérèse Perez-Roux s’inscrivant à la périphérie de l’univers du cirque. Elle rend compte des résultats d’une recherche réalisée entre 2009 et 2011 et portant sur les dynamiques identitaires dans le parcours de professionnalisation des danseuses et des danseurs se formant pour passer le Diplôme d’État de danse : « entre les premières représentations sur l’enseignement de la danse et la projection de soi dans le futur métier, se jouent des transactions qui puisent dans l’expérience passée et présente, ouvrant sur de multiples interactions » (p. 163). Martine Leroy, codirectrice et fondatrice de Balthasar, un centre des arts du cirque à Montpellier, et Martin Gerbier, directeur du centre, s’intéressent pour leur part dans le court chapitre 7 au phénomène de la préprofessionnalisation comme « un temps important lors duquel interagissent construction identitaire et désir artistique pour venir confirmer ou réorienter le projet professionnel » (p. 165). Magali Sizorn, maître de conférences à l’Université de Rouen, propose dans le chapitre 8 un angle de traitement original du phénomène : celui de la maternité des artistes de cirque. Il s’agit là d’un marqueur temporel qui active la crainte de perdre les qualités physiques requises pour exercer sa prestation artistique et celle d’être oubliée au moment du retour. Émilie Salaméro, maître de conférences à l’Université de Poitiers, Samuel Juhle, maître de conférences à l’Université de Bordeaux et Marina Honta, professeure à l’Université de Bordeaux, dans le chapitre 9, posent le problème de la reconversion des artistes de cirque au croisement de regards issus de la sociologie de l’action publique et de la sociologie des professions.
La conclusion de l’ouvrage est l’oeuvre de Philippe Goudard, artiste (clown, auteur de cirque, producteur et interprète de cirque), scientifique (docteur en médecine et en arts du spectacle) et professeur à l’Université Paul-Valéry de Montpellier où il dirige le programme de recherche « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques ». Il rend compte, de manière synthétique, que le cirque participe de l’industrie du spectacle et du divertissement sous différentes modalités : libérale (comme avec le cas du Cirque du Soleil), d’État (les cirques de Moscou et de Pékin, par exemple) ou mixtes. Les valeurs que véhicule le cirque en font, selon lui, un produit idéalement équitable, au fort pouvoir attractif. Il observe que la formation aux arts du cirque intéresse un nombre croissant de filles et de garçons séduits par l’idée de s’épanouir grâce aux métiers du cirque, mais que le milieu professionnel est peu accueillant. « La démocratisation des arts du cirque, nés au creuset des loisirs et du délassement aristocratiques, n’est pas achevée » (p. 222-223), tranche-t-il. Il fonde quelque espoir dans les « États généreux du cirque » où, à compter de 2016, des professionnels du cirque partagent avec le public afin de récolter la parole, les idées et les propositions visant à faire un état des lieux, à réfléchir sur le cirque dans le paysage culturel, sur sa vitalité en France et sur ses répercussions dans le monde.
Une appréciation personnelle
Le livre propose quelques analyses solides sur le phénomène de la professionnalisation des métiers du cirque, notamment celle de Richard Étienne dans le chapitre 1 qui constitue le vecteur fort de l’ouvrage. Sont aussi proposés plusieurs textes descriptifs qui constituent des matériaux de recherche de première importance afin de rendre compréhensible le phénomène de la professionnalisation des métiers du cirque en France. Rappelons que la collection Logiques sociales entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l’action sociale : dans cette perspective, la proposition du collectif respecte ce contrat moral.
Nous avons apprécié la dialectique professionnalisation / déprofessionnalisation présente tout au long de l’ouvrage. Autant les aspects positifs de la professionnalisation sont développés, autant ceux plus négatifs sont rappelés. Inscrites aux pratiques circassiennes, il y a cette volonté artistique de transgresser les règles, cette joute habile pour défier le risque, bref, toutes choses qui vont à l’encontre de quelque phénomène d’uniformisation inhérent à la professionnalisation.
La facture de l’ouvrage est « franco-française », mais on ne saurait le reprocher aux auteurs qui l’annoncent d’emblée. Il est d’ailleurs légitime d’étudier un phénomène à partir de la situation observée sur le plan national. N’empêche que toute incursion dans des espaces géographiques et culturels autres que celui de la France est accueillie avec grand intérêt. Dans son texte trop bref, Philippe Goudard parle du cirque occidental, de l’ex-URSS, de la Chine et de l’Amérique latine. Nous devinons sa connaissance fine de l’univers du cirque et nous apprécions sa posture transdisciplinaire qui contribue magnifiquement à rendre compréhensible le phénomène, dans son essence et dans sa complexité. Nous aurions lu avec grand intérêt un substantiel chapitre de mise en contexte, signé Philippe Goudard, au croisement de ses préoccupations et de son expérience d’artiste de cirque, de scientifique et d’universitaire.
La mise en bouche proposée en début d’ouvrage et présentant le témoignage d’Annie Fratellini est aussi trop brève. Cette femme a vécu, depuis les années 1970, l’institutionnalisation de la formation au métier du cirque et sa professionnalisation, sans compter sa filiation à l’une des plus grandes familles dynastiques du cirque. Nous pouvons espérer que son témoignage, couplé avec celui d’autres figures marquantes du domaine – Pierre Etaix notamment – soit colligé afin d’être accessible aux chercheurs intéressés par le monde circassien.
L’ouvrage saura-t-il trouver son lectorat ? Nous le souhaitons, mais cela constitue toujours un défi. Ceux et celles qui s’intéressent à la professionnalisation trouveront dans ces pages plusieurs références théoriques d’une grande pertinence. Les amants du cirque découvriront un aspect de cette institution assez peu mis en évidence jusqu’à maintenant. Cela dit, ce livre mérite grandement d’être lu, surtout par les lecteurs et les lectrices de Phronesis, d’emblée intéressés par les problématiques relatives à la professionnalisation des métiers adressés à autrui.
Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes. Entre domination et autonomie
 François Aubry et Yves Couturier (2014). (Dir.). Préface de Michel Lemelin. Éditeur : Presses universitaires de Québec
François Aubry et Yves Couturier (2014). (Dir.). Préface de Michel Lemelin. Éditeur : Presses universitaires de Québec
Lien vers le site de l’éditeur
Par Eliane Rothier Bautzer, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, France
François Aubry et Yves Couturier proposent un ouvrage très bien documenté, basé sur la présentation de recherches de terrain, essentiellement de type ethnographique, sur le travail des préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes. Ils montrent que ces acteurs font l’objet d’une injonction paradoxale : porteurs de pressions et de responsabilisation, ils ne peuvent cependant pas s’appuyer sur les ressources et conditions organisationnelles et institutionnelles qui leur permettraient de développer et de faire reconnaitre les compétences requises pour répondre aux situations dans lesquelles ils sont plongés.
Cet ouvrage contribue – dans la ligne des recherches menées par Anne-Marie Arborio et Pascale Molinier sur les aides-soignantes – à produire des connaissances sur un public encore bien peu étudié sur le terrain des pratiques de soin et d’accompagnement. Dans le contexte québéquois, de tels travaux ont été initiés par François Aubry, Yves Couturier et Francis Etheridge. Faisant suite à un colloque, ce livre témoigne de la vigueur de la dynamique de recherche ici désormais instaurée sur un public dont l’importance et la complexité croissante du travail commence à se faire jour grâce à ces recherches scientifiques.
En effet, ce public est dédié mais aussi relégué aux tâches relevant de la catégorie généralement définie par le care. Il produit des connaissances et compétences qui sont souvent peu visibles, source d’autonomie et d’autonomisation limitées pour celles qui les pratiquent. Moins connu et reconnu que les infirmières et médecins, il assure néanmoins, comme le rappelle François Aubry en introduction, 80 à 90 % des actes de soin envers patients et résidents. Ce public est aussi à 80 % représenté par des femmes au Québec et 90 % en France, ce qui constitue l’un des aspects important à considérer si l’on veut comprendre les fondements symboliques de sa domination et certaines impasses de sa professionnalisation.
Si les aides-soignantes (dénomination en France et en Belgique) ou les préposés aux bénéficiaires (appellation québecoise) ont le plus souvent une faible visibilité dans l’espace médiatique, elles apparaissent néanmoins lors du dévoilement de cas de maltraitance envers leurs aînés. Seule la face négative de l’activité de certains est alors médiatisée.
Or, ces faits, méconnaissance d’un côté, médiatisation des déviances de l’autre, nuisent aux termes du débat. En effet, les auteurs du livre soulignent, par leurs travaux de terrain et analyses, la responsabilité croissante de ces personnes soignantes. Elles doivent réaliser des pratiques de qualité, tout en étant soumises à de fortes charges de travail dans un contexte de rapports hiérarchiques qui a très peu évolué. Conjointement, elles doivent faire face aux revendications croissantes des résidents et de leurs familles. Ce contexte et ces charges accrues induisent pour elles des problèmes de santé et de sécurité au travail qui s’avèrent récurrents.
L’ouvrage montre les différences importantes qui peuvent marquer ces pratiques selon qu’elles se déroulent au domicile des personnes ou en institutions. Surtout, il ne se contente pas de décrire, ce qui serait déjà fort utile, le travail des professionnels et les difficultés qui leur sont propres, il propose aussi une analyse de ces difficultés qu’on peut résumer, sans les réduire les unes aux autres, par une vision systémique.
Ainsi, les auteurs s’accordent pour montrer que les situations médiatisées de maltraitance de personnes vulnérables, loin de reposer uniquement sur celui ou celle qui est alors dénoncé, comportent une dimension politique, organisationnelle, institutionnelle qui, tout autant que l’acte déviant, est à relever. Sinon – et jusqu’ici c’est souvent le cas – l’individualisation de la réponse nuit à la résolution du problème de fond.
Les organisations hiérarchisées, pyramidales, dans la ligne de l’organisation hospitalière, laissent peu d’initiatives reconnues aux personnes qui travaillent directement et dans la durée auprès des personnes vulnérables. Les modes de gestions tayloriens peuvent venir s’inscrire à l’encontre des finalités pourtant assignées à ces professionnels en matière de centration sur les besoins des personnes soignées.
Ces professionnels exercent des activités amenées à croître, avec le vieillissement de la population alors même qu’elles s’exercent déjà sous tensions fortes. Ces tensions sont à rattacher à la fois aux modes organisationnels de gestion de ces activités, aux difficultés inhérentes aux situations d’incertitudes rencontrées par les personnes et les équipes, à la nature de ces activités qui intriquent inévitablement sphère privée, intimité, relations affectives, familiales et professionnelles.
Le manque de reconnaissance que ces personnes subissent et les pressions croissantes qui s’exercent sur elles dans un contexte où la tension au niveau des coûts, vient se cumuler aux autres, sans que les moyens pour y faire face soient déployés de façon cohérente. Ce processus engendre inévitablement une certaine labilité dans l’exercice de ce travail qui, en boucle, nourrit les difficultés précitées.
Présentation des différentes parties de l’ouvrage
L’ouvrage est construit sur la base de plusieurs études sur les aides-soignantes et les préposés aux bénéficiaires. Elles travaillent soit dans les organisations de soins et de santé, soit à domicile. L’ensemble de ces terrains est donc abordé sous la forme de quatre thématiques transversales à trois contextes. Ces thématiques sont les suivantes : le rapport aux patients et aux résidents, l’approche du Milieu de Vie[1] et la qualité des pratiques, la santé au travail, la professionnalisation des aides-soignantes et des préposés aux bénéficiaires.
Dans la première partie, les auteurs relèvent l’importance fondamentale de l’organisation du travail dans le développement des conflits et des actes de maltraitance et la nécessité de prendre en compte le collectif de travail dans la réalisation d’actes relationnels de qualité.
Emilie Raizenne montre, sur le terrain des centres d’hébergement et de soins de longue durée, que les préposés sont au cœur des tensions entre revendications individuelles et injonctions organisationnelles. Ils éprouvent de ce fait une grande souffrance morale sur laquelle ils disposent de peu de leviers pour pouvoir agir. Louise Belzile, Caroline Pelletier et Marie Beaulieu se sont intéressées à la maltraitance en institution de soins de longue durée. Cette dernière concerne le plus souvent les aspects non techniques, mais relationnels de leur rôle. Or, les auteurs montrent que la responsabilité des situations de maltraitance, loin de reposer uniquement sur des individus déviants, relève d’un processus distribué au sein des organisations. Ces dernières tendent à faire porter sur les relations interindividuelles entre préposés et bénéficiaires l’incertitude des situations de soins complexes en milieu collectif. Isabelle Feillou, Marie Bellemare, Annabelle Viau-Guay, Louis Trudel, Johanne Desrosiers et Marie-Josée Robitaille ont travaillé sur l’approche relationnelle des soins en institutions de soins de longue durée. Cette approche est ancrée sur la philosophie du Milieu de Vie. Ils relèvent avec prudence — dans la mesure où l’étude concerne un terrain particulier — les questions posées par le déploiement de cette approche. Selon eux, elle s’avèrerait d’autant plus efficace qu’elle concernerait l’ensemble du collectif de travail impliqué dans l’institution et non seulement une catégorie ciblée de personnel.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, sont analysés les effets des nouvelles normes de qualité de l’Approche Milieu de Vie — impulsées au sein des organisations gériatriques — sur les pratiques concrètes des préposés aux bénéficiaires. Les auteurs montrent comment les responsabilités accrues pour les préposés rencontrent les contraintes liées à la faiblesse de leur statut professionnel avec une faible marge d’autonomie et de reconnaissance dans l’organisation. Yves Couturier, Francis Etheridge et Malika Boudjémaa analysent la double contrainte dans laquelle sont pris les préposés aux bénéficiaires : ils sont à la fois poussés à une professionnalisation, mais ne bénéficient pas d’un contexte de travail qui lui soit favorable. Ils soulignent notamment le poids des références asilaires ou hospitalières sur des modèles de prises en charge mal adaptés au soin des personnes âgées malades chroniques. Les préposés, comme les bénéficiaires de leurs actions, sont plongés dans un type d’organisation qui nuit à leurs autonomies tout en promouvant un discours qui la promeut. Malika Boudjémaa et Yves Couturier poursuivent cette analyse en s’attachant à considérer le point de vue des préposés aux bénéficiaires sur l’approche Milieu de vie. Ils soulignent les limites de l’organisation asilaire pour répondre aux problèmes d’hébergement de qualité en institution, ils relèvent des progrès initiés par l’approche Milieu de vie, mais aussi les limites inhérentes aux modes d’organisation et de hiérarchisation encore dominants.
François Aubry, Yves Couturier et Frédéric Gilbert, mettent clairement en évidence que les préposés aux bénéficiaires restent très peu reconnus pour les responsabilités morales croissantes qu’on leur demande cependant d’exercer. Aux prises avec des injonctions organisationnelles et collectives parfois contradictoires, ils mettent pourtant en place des processus d’adaptations aux situations qu’ils vivent qui seraient source d’innovation, pour peu que les gestionnaires de changement en institutions de soins de longue durée s’y intéressent de plus près.
Dans la troisième partie, les auteurs se penchent sur la question de la santé au travail des préposés aux bénéficiaires. Ces derniers sont de plus en plus reconnus comme des acteurs professionnels susceptibles de rencontrer de graves problèmes de santé dans le cadre de leur activité. Les auteurs relèvent que la souffrance organisationnelle est d’autant plus ressentie que ces personnes manquent d’autonomie pour gérer les risques qui les affectent dans la situation de domination où ils se trouvent.
Henriette Bilodeau et Geneviève Robert-Huot se sont intéressées au rapport entretenu par les préposés aux bénéficiaires avec les règles de prévention et de contrôle des infections nosocomiales. Elles soulignent notamment le poids de l’implication du management dans le respect de ces règles par l’ensemble des personnels et non une catégorie en particulier. Johanne Boivin montre que la question de la souffrance au travail dans les organisations de santé est liée à celle de l’autonomie de l’ensemble des personnes impliquées dans les soins. Cette autonomie, loin d’être abstraite, se loge dans l’organisation précise des micros décisions qui s’imposent dans les situations de soins dans lesquelles sont généralement impliqués les préposés aux bénéficiaires. La souffrance organisationnelle résulte d’un manque d’autonomie des personnels les conduisant parfois à agir contre l’éthique des soins, pourtant prônée, lorsqu’ils sont pris dans des injonctions contradictoires.
Fanny Dubois développe une analyse ethnographique du travail des aides-soignantes en Belgique. Elle montre comment leur travail qui consiste aussi à prendre en charge ce qui provoque le dégout des autres tend à asseoir dans cette particularité une facette du pouvoir qui leur est propre.
La quatrième partie explore les conditions nécessaires à la professionnalisation des métiers d’aides-soignantes et des préposés aux bénéficiaires. De par leur faible position statutaire, ils sont en situation de domination hiérarchique, mais aussi symbolique. La qualification de leurs pratiques oscille à la frontière de compétences professionnelles et domestiques.
Catherine Gucher s’est intéressée au travail des aides-soignantes à domicile en France où elles interviennent en croisant les auxiliaires de vie sociale et les aides à domicile. Ces différents intervenants, aux frontières mal définies, œuvrent en tension pour défendre des territoires et des autonomies professionnelles fragiles, et ce, aux dépens de l’autonomie de l’usager face à ces différents modes d’interventions. Il apparaît difficile pour l’ensemble de ces personnes d’être reconnues de par le brouillage, dans ce secteur, entre expertises savante et profane.
Catherine Gucher et Annie Mollier soulignent le rapport étroit entretenu entre le travail des infirmiers et ceux des aides-soignants, les amenant à valoriser les interventions techniques en lien avec l’activité thérapeutique qui fonderait leur légitimité. A domicile, elles cherchent cependant à relier les dimensions techniques et humanistes de leur travail pour mieux défendre un territoire spécifique.
Des territoires sous tension
L’ensemble de l’ouvrage montre la tension générée par cette position paradoxale où les acteurs sont à la fois porteurs de pressions et de responsabilisation, mais conjointement, n’ont pas les ressources et conditions organisationnelles et institutionnelles qui leur permettraient de développer et de faire reconnaitre leurs compétences.
Yves Couturier clôt l’ouvrage par la mise en évidence des débats actuels sur les préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes. Il montre notamment en quoi ils permettent de mettre à jour la problématique de la domination symbolique du métier qui oblitère la forme même des revendications que les acteurs seraient en mesure d’exprimer. Il souligne le paradoxe posé par l’impasse où ces professionnels se trouvent, fondant leur identité sur ce qu’on leur demande d’être plutôt dans ce qu’ils sont. Le chemin vers davantage de reconnaissance et de professionnalité apparaît donc semé d’embuches tant au plan individuel, subjectif, qu’organisationnel et institutionnel. Néanmoins, tant au domicile qu’en institution, ce chemin s’impose d’autant plus que les injonctions et revendications de l’ensemble de ces acteurs tendent à réclamer ou nécessiter davantage d’autonomie d’action et de contrôle. Ce livre trace les principales lignes sur lesquelles ces reconfigurations complexes reposent.
Un bien bel ouvrage dont on ne peut que recommander la lecture, il intéresse autant les chercheurs que les professionnels et les publics des secteurs éducatifs, social et sanitaire.